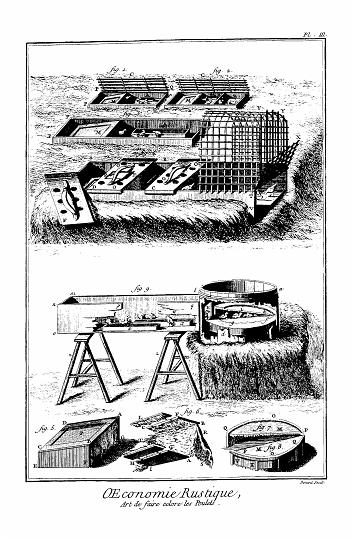S. f. (Morale) Usure légale ou intérêt légitime. La question de l'usure, quoique traitée avec beaucoup de subtilité par les Théologiens et par les Jurisconsultes, parait encore jusqu'ici en quelque sorte indécise ; il parait même, quand on l'approfondit, qu'on a plus disputé sur les termes que sur les idées, et qu'on a presque toujours manqué le but qu'on se proposait ; je veux dire la découverte de la vérité. Cependant cette question également intéressante pour le commerce de la vie et pour la paix des consciences, mérite autant ou plus qu'une autre une discussion philosophique, où la raison ait plus de part que l'opinion ou le préjugé. C'est aussi pour remplir cette vue et dans l'espérance de répandre un nouveau jour sur cette matière importante, que j'ai entrepris cet article.
Plusieurs pratiques dans la Morale sont bonnes ou mauvaises, suivant les différences du plus ou du moins, suivant les lieux, les temps, etc. Qui ne sait, par exemple que les plaisirs de la table, les tendresses de l'amour, l'usage du glaive, celui des tortures ; qui ne sait, dis-je, que tout cela est bon ou mauvais suivant les lieux, les temps, les personnes, suivant l'usage raisonnable, excessif ou déplacé, qu'on en fait ? Je crois qu'il en est de même du commerce usuraire.
Usura chez les Latins signifiait au sens propre l'usage ou la jouissance d'un bien quelconque. Natura, dit Cicéron, dedit usuram vitae tanquam pecuniae, Tusc. lib. I. n °. 39. Usura désignait encore le loyer, le prix fixé par la loi pour l'usage d'une somme prêtée ; et ce loyer n'avait rien d'odieux, comme le remarque un savant jurisconsulte, il n'y avait de honteux en cela que les excès et les abus ; distinction, dit-il, que les commentateurs n'ont pas sentie, ou qu'ils dissimulent mal-à-propos. Certè verbum usura non est foedum, sed non habere usurae modum et honestam rationem est turpissimum ; quod commentatores non intelligunt, aut calumniosè dissimulant. Oldendorp. lexic. jurid. Calvini, verbo usuram, p. 691. col. 1. in-fol. Genevae 1653.
Pour moi, je regarde l'usure comme une souveraine qui régnait autrefois dans le monde, et qui devint odieuse à tous les peuples, par les vexations que des ministres avides et cruels faisaient sous son nom, bien que sans son aveu ; de sorte que cette princesse malheureuse, par-tout avilie et détestée, se vit enfin chassée d'un trône qu'elle avait occupé avec beaucoup de gloire, et fut obligée de se cacher sans jamais oser paraitre.
D'un autre côté, je regarde les intérêts et les indemnités qui ont succédé à l'usure, comme ces brouillons adroits et entreprenans qui profitent des mécontentements d'une nation, pour s'élever sur les ruines d'une puissance décriée ; il me semble, dis-je, que ces nouveaux-venus ne valent pas mieux que la reine actuellement proscrite ; et que s'ils sont plus attentifs et plus habiles à cacher les torts qu'ils font à la société, leur domination est, à bien des égards, encore plus gênante et plus dure. Je crois donc que Ve l'utilité sensible, Ve l'indispensable nécessité d'une usure bien ordonnée, usure aussi naturelle dans le monde moral, que l'est le cours des rivières dans le monde matériel, il vaut autant reconnaître l'ancienne et légitime souveraine que des usurpateurs qui promettaient des merveilles, et qui n'ont changé que des mots. Je prends la plume pour rétablir, s'il se peut, cette reine détrônée, persuadé qu'elle saura se contenir dans les bornes que l'équité prescrit, et qu'elle évitera les excès qui ont occasionné sa chute et ses malheurs ; mais parlons sans figure.
L'usure que nous allons examiner est proprement l'intérêt légal et compensatoire d'une somme prêtée à un homme aisé, dans la vue d'une utilité réciproque. L'usure ainsi modifiée et réduite parmi nous depuis un siècle au denier vingt, est ce que j'appelle usure légale ; je prétends qu'elle n'est point contraire au droit naturel, et que la pratique n'en est pas moins utîle que tant d'autres négociations usitées et réputées légitimes.
Je prouve encore, ou plutôt je démontre que la même usure sous des noms différents est constamment admise par les lois civiles et par tous les casuistes ; que par conséquent toute la dispute se réduit à une question de mots ; et que tant d'invectives, qui attaquent plutôt le terme que la réalité de l'usure, ne sont le plus souvent que le cri de l'ignorance et de la prévention. Je fais voir d'un autre côté qu'elle n'est prohibée ni dans l'ancien Testament, ni dans le nouveau ; qu'elle y est même expressément autorisée ; et je montre enfin dans toute la suite de cet article que la prohibition vague, inconséquente, déraisonnable que l'on fait de l'usure, est véritablement contraire au bien de la société.
La justice ou la loi naturelle nous prescrit de ne faire tort à personne, et de rendre à chacun ce qui lui est dû. alterum non laedere, suum cuique tribuere. Initio instit. C'est le fondement de cette grande règle que le S. Esprit a consacrée, et que les païens ont connue : " Ne faites point aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fit à vous-même ". Quod ab alio oderis fieri tibi, vide ne tu aliquando alteri facias, Tob. 4. 16. ou, si on veut, dans un vers,
Ne facias aliis quae tu tibi facta doleres.
Or quand je prête à des gens aisés à la charge de l'intérêt légal, je ne leur fais pas le moindre tort, je leur rends même un bon office ; et pour peu qu'on les suppose équitables, ils reconnaissent que je les oblige. C'est un voisin que je mets à portée d'arranger des affaires qui le ruinaient en procès, ou de profiter d'une conjoncture pour faire une acquisition avantageuse. C'est un autre qui de mes deniers rétablit une maison qu'on n'habitait point depuis longtemps faute de réparations, ou qui vient à bout d'éteindre une rente foncière et seigneuriale, tandis que je lui donne du temps pour me rembourser à son aise. C'est enfin un troisième qui n'a guère que l'envie de bien faire, et à qui je fournis le moyen d'entreprendre un bon négoce, ou de donner plus d'étendue à celui qu'il faisait auparavant. Quand après cela je reçais de ces débiteurs les capitaux et les intérêts, je ne manque en rien à ce que prescrit la justice, alterum non laedere ; puisque, loin de leur nuire par ce commerce, je leur procure au contraire de vrais avantages ; et qu'en tirant des intérêts stipulés avec eux de bonne foi, je ne tire en effet que ce qui m'appartient, soit à titre de compensation du tort que m'a causé l'absence de mon argent, soit à cause des risques inséparables du prêt.
D'ailleurs un contrat fait avec une pleine connaissance, et dont les conditions respectivement utiles sont également agréées des parties, ne peut pas être censé contrat injuste, suivant une maxime de Droit dont nos adversaires font un principe. Le créancier, disent-ils, est lui-même la cause du dommage qu'il souffre, quand il le souffre de son bon gré et très-volontairement, de sorte que, comme on ne fait aucun tort à celui qui le veut bien, VOLENTI NON FIT INJURIA, le débiteur ne lui doit aucun dédommagement pour tout le temps qu'il veut bien souffrir ce dommage. Confér. ecclés. de Paris sur l'usure, tome I. p. 381. On ne peut rien de plus raisonnable que ces propositions ; mais si elles sont justes quand il s'agit du créancier, elles ne changent pas de nature quand on les applique au débiteur ; c'est aussi en partie sur cette maxime, volenti non fit injuria, que nous appuyons notre prêt lucratif.
Un importun me sollicite de lui prêter une somme considérable, et il en résulte souvent qu'au lieu de laisser mes fonds dans les emprunts publics, au-lieu de les y porter, s'ils n'y sont pas encore, ou de faire quelqu'autre acquisition solide, je cede à ses importunités ; en un mot, je lui donne la préférence, et je livre mon bien entre ses mains à la condition qu'il me propose de l'intérêt ordinaire ; condition du reste que je remplis comme lui toutes les fois que j'emprunte. Peut-on dire qu'il y ait de l'injustice dans mon procédé ? N'est-il point vrai plutôt que je péche contre moi-même en m'exposant à des risques visibles, et que j'ai tort enfin de céder à des sentiments d'humanité dont je deviens souvent la victime, tandis que les dévots armés d'une sévère prudence se contentent de damner les usuriers, laissent crier les importuns, et font de leur argent des emplois plus surs et plus utiles. Mais lequel mérite mieux le nom de juste et de bienfaisant de celui qui hasarde ses fonds pour nous aider au besoin en stipulant l'intérêt légal, ou de celui qui, sous prétexte d'abhorrer l'usure, met son argent dans le commerce ou à des acquisitions solides ; qui en conséquence ne prête à personne, et abandonne ainsi les gens dans leurs détresses, sans leur donner un secours qui leur serait très-profitable, et qui dépend de lui ?
Quoi qu'il en sait, on le voit par notre définition de l'usure, il n'est ici question ni d'aumône, ni de générosité. Ce n'est point d'ordinaire dans cet esprit que se font les stipulations et les contrats. Est-ce pour se rendre agréable à Dieu ; est-ce pour bien mériter de la patrie qu'un homme de qualité, qu'un bourgeois opulent, qu'un riche bénéficier louent leurs maisons et leurs terres ? est-ce pour gagner le ciel qu'un seigneur ecclésiastique ou laïc exige de ses prétendus vassaux des redevances de toute nature ? Non certainement. Ce n'est point aussi par ce motif qu'on prête ou qu'on loue son argent ; mais tous les jours l'on prête et l'on emprunte dans la vue très-louable d'une utilité réciproque. En un mot, l'on prend et l'on donne à louage une somme de mille écus, de dix ou vingt mille francs, comme l'on donne et l'on prend au même titre une terre, une maison, une voiture, un navire, le tout pour profiter et pour vivre de son industrie ou de ses fonds. Et si jamais on prête une grande somme par pure générosité, ce n'est point en vertu de la loi, mais par le mouvement libre d'un cœur bienfaisant. Aussi, comme le dit un illustre moderne, c'est bien une action très-bonne de prêter son argent sans intérêt, mais on sent que ce ne peut être qu'un conseil de religion, et non une loi civile. Esprit des lois, seconde partie, p. 120.
Un homme qui avait beaucoup bâti, se voyait encore une somme considérable, et las d'occuper des maçons, résolut d'employer son argent d'une autre manière. Il mit un écriteau à sa porte, on lisait en tête : Belle maison à louer, prix quinze cent livres par an. On lisait au-dessous : Dix mille écus à louer aux mêmes conditions. Un génie vulgaire et borné voyant cet écriteau ; à la bonne heure, dit-il, qu'on loue la maison, cela est bien permis ; mais la proposition de louer une somme d'argent est mal-sonnante et digne de repréhension, c'est afficher ouvertement l'usure, et rien de plus scandaleux. Quelqu'un plus sensé lui dit alors : Pour moi, monsieur, je ne vois point là de scandale. Le proposant offre pour cinq cent écus une maison commode, qui lui coute environ trente mille livres, la prendra qui voudra, il ne fait tort à personne, et vous paraissez en convenir. Il offre pareille somme de trente mille livres à tout solvable qui en aura besoin à la même condition de cinq cent écus de loyer, quel tort fait-il à la république ? Avec son argent il pourrait acquérir un fonds, et le louer aussi-tôt sans scrupule. Que notre proposant offre ses dix mille écus en nature, ou qu'il nous les offre sous une autre forme, c'est la même chose pour lui ; mais quelqu'un qui aura plus besoin d'argent que d'un autre bien, sera charmé de trouver cette somme en espèces, et il en payera volontiers ce qu'un autre payerait pour un domaine de pareille valeur. Rien de plus équitable, rien en même temps de plus utîle au public ; et de cent personnes qui seront dans le train des emprunts, on n'en trouvera pas deux qui ne soient de mon avis.
S'il est plusieurs genres d'opulence, il est aussi plusieurs genres de communication. Ainsi tel est riche par les domaines qu'il donne à bail, et par l'argent qu'il donne à louage.
Dives agris, dives positis in foenore nummis.
Horace, l. I. sat. IIe
Celui-ci, comme terrien, se rend utîle au public, en ce qu'il loue ses terres, et qu'il procure l'abondance ; il ne se rend pas moins utîle comme pécunieux en mettant ses espèces à intérêt ou à louage entre les mains de gens qui en usent pour le bien de la société. S'il suivait au contraire l'avis de certains casuistes, et que pour éviter l'usure il tint ses espèces en réserve, il servirait le public aussi mal que si, au-lieu de louer ses terres, il les tenait en bruières et en landes. Ce qui fait dire à Saumaise dans le savant traité qu'il a fait sur cette matière, que la pratique de l'usure n'est pas moins nécessaire au commerce que le commerce l'est au labourage, ut agricultura sine mercaturâ vix potest subsistère.... ita nec mercatura sine feneratione stare : de usuris, p. 223.
Par quelle fatalité l'argent ne serait-il donc plus, comme autrefois, susceptible de louage ? On disait anciennement locare nummos, louer de l'argent, le placer à profit ; de même, conducère nummos, prendre de l'argent à louage ; il n'y avait en cela rien d'illicite ou même d'indécent, si ce n'est lorsque des amis intimes auraient fait ce négoce entr'eux, commodare ad amicos pertinet, foenerari ad quoslibet. Salmasius ex Suida, c. VIIe de usuris, p. 163.
Un homme en état de faire de la dépense, use de l'argent qu'on lui prête à intérêt, ou, pour mieux dire, qu'on lui loue, comme d'une maison de plaisance qu'on lui prête à la charge de payer les loyers, comme d'un carrosse de remise qu'on lui prête à tant par mois ou par an ; je veux dire qu'il paye également le louage de l'argent, de la maison et du carrosse ; et pour peu qu'il eut d'habileté, le premier lui serait plus utîle que les deux autres. Il est à remarquer en effet au sujet d'un homme riche un peu dissipateur, que l'emprunt de l'argent aux taux légal est tout ce qu'il y a pour lui de plus favorable. Car s'il se procure à crédit les marchandises, le service et les autres fournitures qu'exigent ses fantaisies ou ses besoins, au-lieu de cinq pour cent qu'il payerait pour le prêt des espèces, il lui en coutera par l'autre voie au-moins trente ou quarante pour cent ; ce qui joint au renouvellement des billets et aux poursuites presqu'inévitables pour parvenir au payement définitif, lui fera d'ordinaire cent pour cent d'une usure écrasante.
Au surplus, pourquoi l'argent, le plus commode de tous les biens, serait-il le seul dont on ne put tirer profit ? et pourquoi son usage serait-il plus gratuit, par exemple, que la consultation d'un avocat et d'un médecin, que la sentence d'un juge ou le rapport d'un expert, que les opérations d'un chirurgien, ou les vacations d'un procureur ? Tout cela, comme on sait, ne s'obtient qu'avec de l'argent. On ne trouve pas plus de générosité parmi les possesseurs des fonds. Que je demande aux uns quelque portion de terre pour plusieurs années, je suis par-tout éconduit si je ne m'engage à payer ; que je demande à d'autres un logement à titre de grâce, je ne suis pas mieux reçu que chez les premiers. Je suis obligé de payer l'usage d'un meuble au tapissier ; la lecture d'un livre au libraire, et jusqu'à la commodité d'une chaise à l'église.
Envain je représente que Dieu défend d'exiger aucune rétribution, ni pour l'argent prêté, ni pour les denrées, ni pour quelqu'autre chose que ce puisse être. J'ai beau crier, non foenerabis fratri tuo ad usuram pecuniam, nec fruges, nec quamlibet aliam rem. Deut. xxiij. 19. Personne ne m'écoute, je trouve tous les hommes également intéressés, également rebelles au commandement de prêter gratis ; au point que si on ne leur présente quelque avantage, ils ne communiquent d'ordinaire ni argent, ni autre chose ; disposition qui les rend vraiment coupables d'usure, au moins à l'égard des pauvres ; puisque l'on n'est pas moins criminel, soit qu'on refuse de leur prêter, soit qu'on leur prête à intérêt. C'est l'observation judicieuse que faisait Grégoire de Nisse aux usuriers de son temps, dans un excellent discours qu'il leur adresse, et dont nous aurons occasion de parler dans la suite.
Du reste, sentant l'utilité de l'argent qui devient nécessaire à tous, j'en emprunte dans mon besoin chez un homme pécunieux, et n'ayant trouvé jusqu'ici que des gens attachés qui veulent tirer profit de tout, qui ne veulent prêter gratis ni terres, ni maisons, ni soins, ni talents, je ne suis plus surpris que mon prêteur d'espèces en veuille aussi tirer quelque rétribution, et je souffre, sans murmurer, qu'il m'en fasse payer l'usure ou le louage.
C'est ainsi qu'en réfléchissant sur l'esprit d'intérêt qui fait agir tous les hommes, et qui est l'heureux, l'immuable mobîle de leurs communications, je vois que la pratique de l'usure légale entre gens aisés, n'est ni plus criminelle, ni plus injuste que l'usage respectivement utîle de louer des terres, des maisons, etc. je vois que ce commerce vraiment destiné au bien des parties intéressées, est de même nature que tous les autres, et qu'il n'est en soi ni moins honnête, ni moins avantageux à la société.
Pour confirmer cette proposition, et pour démontrer sans réplique la justice de l'intérêt légal, je suppose qu'un père laisse en mourant à ses deux fils, une terre d'environ 500 livres de rente, outre une somme de 10000 livres comptant. L'ainé choisit la terre, et les 10000 livres passent au cadet. Tous les deux sont incapables de faire valoir eux-mêmes le bien qu'ils ont hérités ; mais il se présente un fermier solvable, qui offre de le prendre pour neuf années, à la charge de payer 500 livres par an pour la terre, et la même somme annuelle pour les 10000 livres : sera-t-il moins permis à l'un de louer son argent, qu'à l'autre de louer son domaine ?
Un fait arrivé, dit-on depuis peu, servira bien encore à éclaircir la question. Un simple ouvrier ayant épargné 3000 francs, par plusieurs années de travail et d'économie, se présenta pour louer une maison qui lui convenait fort, et qui valait au moins 50 écus de loyer. Le propriétaire, homme riche et en même temps éclairé, lui dit : " Mon ami, je vous donnerai volontiers ma maison ; mais j'apprents que vous avez 1000 écus qui ne vous servent de rien ; je les prendrai, si vous voulez, à titre d'emprunt, et vous en tirerez l'intérêt qui payera votre loyer : ainsi vous serez bien logé, sans débourser un sou. Pensez-y, et me rendez réponse au plus tôt ".
L'ouvrier revenant chez lui, rencontre son curé, et par forme de conversation, lui demande son avis sur le marché qu'on lui proposait. Le curé, honnête homme au fond, mais qui ne connaissait que ses cahiers de morale et ses vieux préjugés, lui défend bien de faire un tel contrat, qui renferme, selon lui, l'usure la plus marquée, et il en donne plusieurs raisons que celui-ci Ve rapporter à notre propriétaire.
Monsieur, dit-il, votre proposition me convenait fort, et je l'eusse acceptée volontiers ; mais notre curé à qui j'en ai parlé, n'approuve point cet arrangement. Il tient qu'en vous remettant mes mille écus, c'est de ma part un véritable prêt, qui est une affaire bien délicate pour la conscience. Il prétend que l'argent est stérîle par lui-même, que dès que nous l'avons prêté, il ne nous appartient plus, et que par-conséquent il ne peut nous produire un intérêt légitime. En un mot, dit-il, un prêt quelconque est gratuit de sa nature, et il doit l'être en tout et par-tout ; et bien d'autres raisons que je n'ai pas retenues. Il m'a cité là-dessus l'ancien et le nouveau Testament, les conciles, les saints pères, les décisions du clergé, les lois du royaume ; en un mot, il m'a réduit à ne pas répondre, et je doute fort que vous y répondiez vous-même.
Tiens mon ami, lui dit notre bourgeois, si tu étais un peu du métier de philosophe et de savant, je te montrerais que ton curé n'a jamais entendu la question de l'usure, et je te ferais toucher au doigt le faible et ridicule de ses prétentions ; mais tu n'as pas le temps d'écouter tout cela : tu t'occupes plus utilement, et tu fais bien. Je te dirai donc en peu de mots, ce qui est le plus à ta portée ; savoir que le commandement du prêt gratuit ne regarde que l'homme aisé vis-à-vis du nécessiteux. Il est aujourd'hui question pour toi de me prêter une somme assez honnête, mais tu n'es pas encore dans une certaine aisance, et il s'en faut beaucoup que je sois dans la nécessité. Ainsi en me prêtant gratuitement, tu ferais une sorte de bonne œuvre qui se trouverait fort déplacée ; puisque tu prêterais à un homme aisé beaucoup plus riche que toi : et c'est-là, tu peux m'en croire, ce que l'Ecriture ni les saints pères, n'ont jamais commandé ; je me charge de le démontrer à ton curé quand il le voudra.
D'ailleurs nous avons une règle infaillible pour nous diriger dans toutes les affaires d'intérêt : règle de justice et de charité que J. C. nous enseigne, et que tu connais sans doute, c'est de traiter les autres comme nous souhaitons qu'ils nous traitent ; or, c'est ce que nous faisons tous les deux dans cette occasion, ainsi nous voilà dans le chemin de la droiture. Nous sentons fort bien que le marché dont il s'agit, nous doit être également profitable, et par conséquent qu'il est juste, car ces deux circonstances ne vont point l'une sans l'autre. Mais que tu me laisses l'usage gratuit d'une somme considérable, et que tu me payes outre cela le loyer de ma maison, c'est faire servir les sueurs du pauvre à l'agrandissement du riche ; c'est rendre enfin ta condition trop dure, et la mienne trop avantageuse. Soyons plus judicieux et plus équitables. Nous convenons de quelques engagements dont nous sentons l'utilité commune, remplissons-les avec fidélité. Je t'offre ma maison, et tu l'acceptes parce qu'elle te convient, rien de plus juste ; tu m'offres une somme équivalente, je l'accepte de même, cela est également bien. Du reste, comme je me réserve le droit de reprendre ma maison, tu conserves le même droit de répéter ton argent. Ainsi nous nous communiquons l'un l'autre un genre de bien que nous ne voulons pas aliéner ; nous consentons seulement de nous en abandonner le service ou l'usage. Tiens, tout soit dit, troc pour troc, nous sommes contens l'un de l'autre, et ton curé n'y a que faire. Ainsi se conclut le marché.
Les emprunteurs éclairés se moquent des scrupules qu'on voudrait donner à ceux qui leur prêtent. Ils sentent et déclarent qu'on ne leur fait point de tort dans le prêt de commerce. Aussi voit-on tous les jours des négociants et des gens d'affaires, qui en qualité de voisins, de parents même, se prêtent mutuellement à charge d'intérêt ; en cela fidèles observateurs de l'équité, puisqu'ils n'exigent en prêtant, que ce qu'ils donnent sans répugnance toutes les fois qu'ils empruntent. Ils reconnaissent que ces conditions sont également justes des deux côtés ; qu'elles sont même indispensables pour soutenir le commerce. Les prétendus torts qu'on nous fait, disent-ils, ne sont que des torts imaginaires ; si le prêteur nous fait payer l'intérêt légal, nous en sommes bien dédommagés par les gains qu'ils nous procurent, et par les négociations que nous faisons avec les sommes empruntées. En un mot, dans le commerce du prêt lucratif, on nous vend un bien qu'il est utîle d'acheter, que nous vendons quelquefois nous-mêmes, c'est-à-dire l'usage de l'argent, et nous trouvons dans ce négoce actif et passif, les mêmes avantages qu'en toutes les autres négociations.
Ces raisons servent à justifier l'usage où l'on est de vendre les marchandises plus ou moins cher, selon que l'acheteur paye comptant ou en billets. Car si la nécessité des crédits est bien constante, et l'on n'en peut disconvenir, il s'ensuit que le fabriquant qui emprunte, et qui paye en conséquence des intérêts, peut les faire payer à tous ceux qui n'achetent pas au comptant. S'il y manquait, il courait risque de ruiner ses créanciers, en se ruinant lui-même. Car le vendeur obligé de payer l'intérêt des sommes qu'il emprunte, ne peut s'empêcher de l'imputer comme frais nécessaires, sur tout ce qui fait l'objet de son négoce, et il ne lui est pas moins permis de se le faire rembourser par ceux qui le paient en papier, que de vendre dix sols plus cher une marchandise qui revient à dix sols de plus.
Il n'y a donc pas ici la plus légère apparence d'injustice. On y trouve au contraire une utilité publique et réelle, en ce que c'est une facilité de plus pour les virements du commerce ; et là-dessus les négociants n'iront pas consulter Lactance, S. Ambraise ou S. Thomas, pour apprendre ce qui leur est avantageux ou nuisible. Ils savent qu'en fait de négociation, ce qui est réciproquement utile, est nécessairement équitable. Qu'est-ce en effet, que l'équité, si ce n'est l'égalité constante des intérêts respectifs, aequittas ab aequo ? Quand le peuple voit une balance dans un parfait équilibre, voilà, dit-il, qui est juste ; expression que lui arrache l'identité sensible de la justice et de l'égalité ;
Scis etenim justum geminâ suspendere lance.
Perse, IV. 10.
Qu'on reconnaisse donc ce grand principe de tout commerce dans la société. L'avantage réciproque des contractants est la commune mesure de ce que l'on doit appeler juste ; car il ne saurait y avoir d'injustice où il n'y a point de lésion. C'est cette maxime toujours vraie, qui est la pierre de touche de la justice ; et c'est elle qui a distingué le faux nuisible, d'avec celui qui ne préjudicie à personne : nullum falsum nisi nocivum.
Le sublime philosophe que nous avons déjà cité, reconnait la certitude de cette maxime, quand il dit d'un ancien règlement, publié jadis à Rome sur le même sujet. " Si cette loi était nécessaire à la république, si elle était utîle à tous les particuliers, si elle formait une communication d'aisance entre le débiteur et le créancier, elle n'était pas injuste ". Esprit des lois, II. part. p. 127.
Au reste, pour développer de plus en plus cette importante vérité, remontons aux vues de la législation. Les puissances ne nous ont pas imposé des lois par caprice, ou pour le vain plaisir de nous dominer : Sit pro ratione voluntas. Juv. sat. VIe mais pour garantir les imprudents et les faibles de la surprise et de la violence ; et pour établir dans l'état le règne de la justice : tel est l'objet nécessaire de toute législation. Or, si la loi prohibitive de l'intérêt modéré, légal, se trouve préjudiciable aux sujets, cette loi destinée comme toutes les autres à l'utilité commune, est dès-lors absolument opposée au but du législateur ; par conséquent elle est injuste, et dès-là elle tombe nécessairement en désuétude. Aussi est-ce ce qui arrivera toujours à l'égard des règlements qui proscriront l'intérêt dont nous parlons ; parce qu'il n'est en effet qu'une indemnité naturelle, indispensable ; indemnité non moins difficîle à supprimer que le loyer des terres et des autres fonds. C'est aussi pour cette raison que les législateurs ont moins songé à le proscrire, qu'à le régler à l'avantage du public ; et par conséquent c'est n'avoir aucune connaissance de l'équité civile, que de condamner l'intérêt dont il s'agit. Mais cela est pardonnable à des gens qui ont plus étudié la tradition des mots que l'enchainement des idées ; et qui n'ayant jamais pénétré les ressorts de nos communications, ignorent en conséquence les vrais principes de la justice, et les vrais intérêts de la société.
Qu'il soit donc permis à tout citoyen d'obtenir pour un prix modique ce que personne ne voudra lui prêter gratis ; il en sera pour lors des vingt-mille francs qu'il emprunte, comme des bâtiments qu'il occupe, et dont il paye le loyer tous les ans, parce qu'on ne voudrait, ou plutôt parce qu'on ne pourrait lui en laisser gratuitement l'usage.
Ce qui induit bien des gens en erreur sur la question présente, c'est que d'un côté les ennemis de l'usure considèrent toujours le prêt comme acte de bienveillance, essentiellement institué pour faire plaisir à un confrère et à un ami. D'un autre côté, les honnêtes usuriers font trop valoir l'envie qu'ils ont communément d'obliger ; ils gâtent par là leur cause, croyant la rendre meilleure, et donnent ainsi prise sur eux. Car voici le captieux raisonnement que leur fait Domat du prêt et de l'usure, tit. VIe sect. j. p. 76. édit. de 1702. " Toute la conséquence, dit-il, que peut tirer de cette bonne volonté de faire plaisir, le créancier qui dit qu'il prête par cette vue, c'est qu'il doit prêter gratuitement ; et si le prêt ne l'accommode pas avec cette condition qui en est inséparable, il n'a qu'à garder son argent ou en faire quelque autre usage.... puisque le prêt n'est pas inventé pour le profit de ceux qui prêtent, mais pour l'usage de ceux qui empruntent ".
J'aimerais autant qu'on prescrivit aux loueurs de carrosse, ou de prêter leurs voitures gratis à ceux qui en ont besoin, ou de les garder pour eux-mêmes, si la gratuité ne les accommode, par la prétendue raison que les carrosses ne sont pas inventés pour le profit de ceux qui les équipent, mais pour l'usage de ceux qui se font voiturer : qu'on prescrivit à l'avocat et au médecin de faire leurs fonctions gratuitement, ou de se reposer si la condition ne leur agrée pas ; parce que leurs professions nobles ne sont pas inventées pour le lucre de ceux qui les exercent, mais pour le bien des citoyens qui en ont besoin. Comme si l'on faisait les frais d'une voiture ou d'un bâtiment, comme si l'on se rendait capable d'une profession, comme si l'on amassait de l'argent par d'autre motif et pour d'autre fin que pour ses besoins actuels, ou pour en tirer d'ailleurs quelque profit ou quelque usure. En un mot, il doit y avoir en tout contrat une égalité respective, une utilité commune en faveur des intéressés ; par conséquent il n'est pas juste dans notre espèce d'attribuer à l'emprunteur tout l'avantage du prêt, et de ne laisser que le risque pour le créancier : injustice qui rejaillirait bientôt sur le commerce national, à qui elle ôterait la ressource des emprunts.
Domat, au reste, ne touche pas le vrai point de la difficulté. Il ne s'agit pas de savoir quelle est la destination primitive du prêt, ni quelle est la vue actuelle du prêteur ; toutes ces considérations ne font rien ici : cogitare tuum nil ponit in re. Il s'agit simplement de savoir si le prêt d'abord imaginé pour obliger un ami, peut changer sa première destination, et devenir affaire de négoce dans la société ; sur quoi je soutiens qu'il le peut, aussi-bien que l'ont pu les maisons qui étaient destinées dans l'origine que pour loger le bâtisseur et sa famille, et qui dans la suite sont devenues un juste objet de location ; aussi-bien que l'ont pu les voitures que l'inventeur n'imagina que pour sa commodité, sans prévoir qu'on dû. les donner un jour à loyer et ferme. En un mot, la question est de savoir si le créancier qui ne veut pas faire un prêt gratuit auquel il n'est pas obligé, peut sans blesser la justice accepter les conditions légales que l'emprunteur lui propose, et qu'il remplit lui-même sans répugnance toutes les fois qu'il recourt à l'emprunt. Décidera-t-on qu'il y a de l'inique et du vol dans un marché où le prétendu maltraité n'en voit point lui-même ? Croira-t-on qu'un homme habîle soit lésé dans un commerce dont il connait toutes les suites, et où loin de trouver de la perte, il trouve au contraire du profit ; dans un commerce qu'il fait également comme bailleur et comme preneur, et où il découvre dans les deux cas de véritables avantages ?
Rappelons ici une observation que nous avons déjà faite ; c'est que le trafiqueur d'argent ne songe pas plus à faire une bonne œuvre ou à mériter par le prêt les bénédictions du ciel, que celui qui loue sa terre ou sa maison, ses travaux ou ses talents. Ce ne sont guère là les motifs d'un homme qui fait des affaires ; il ne se détermine pas non-plus par de simples motifs d'amitié, et il prête moins à la personne qu'aux hypothèques et aux facultés qu'il connait ou qu'il suppose à l'emprunteur ; de sorte qu'il ne lui prêterait pas, s'il ne le croyait en état de rendre ; comme un autre ne livre pas sa marchandise ou sa maison à un homme dont l'insolvabilité lui est connue. Ainsi l'on pourrait presque toujours dire comme Martial,
Quod mihi non credis veteri, Thelesine, sodali,
Credis cauliculis, arboribusque meis. l. XII. épig. 25.
Notre prêteur, comme l'a bien observé le président Perchambaut, fait moins un prêt qu'un contrat négociatif ; sa vue première et principale est de subsister sur la terre, et de faire un négoce utîle à lui-même et aux autres ; et il a pour cela le même motif que l'avocat qui plaide, que le médecin qui voit des malades, que le marchand qui trafique, et ainsi des autres citoyens dont le but est de s'occuper avec fruit dans le monde, et de profiter du commerce établi chez les nations policées ; en quoi ils s'appuient les uns et les autres sur ce grand principe d'utilité commune qui rassembla les premiers hommes en corps, et qui leur découvrit tout-à-la-fais les avantages et les devoirs de la société ; avantage par exemple dans notre sujet de disposer utilement d'une somme qu'on emprunte ; devoir d'en compenser la privation à l'égard de celui qui la livre.
Cujus commoda sunt, ejusdem incommoda sunto.
Quant à l'option que nous laisse Domat, ou de garder notre argent, ou de le prêter gratis, il faut pour parler de la sorte, n'avoir jamais lu l'Ecriture, ou avoir oublié l'exprès commandement qu'elle fait de prêter en certains cas, dû.-on risquer de perdre sa créance, Deut. XVe 7. 8.
Il faut de même n'avoir aucune expérience du monde et des différentes situations de la vie ; combien de gens, qui sentent l'utilité des emprunts, et qui n'approuveront jamais qu'on nous prescrive de ne faire aucun usage de notre argent, plutôt que de le prêter à charge d'intérêt ; qui trouveront enfin ce propos aussi déraisonnable que si l'on nous conseillait de laisser nos maisons sans locataires, plutôt que d'en exiger les loyers ; de laisser nos terres sans culture, plutôt que d'en percevoir les revenus !
Tout est mêlé de bien et de mal dans la vie, ou plutôt nos biens ne sont d'ordinaire que de moindres maux. C'est un mal par exemple d'acheter sa nourriture, mais c'est un moindre mal que de souffrir la faim ; c'est un mal de payer son gîte, mais c'est un moindre mal que de loger dans la rue ; c'est un mal enfin d'être chargé d'intérêts pour une somme qu'on emprunte, mais c'est un moindre mal que de manquer d'argent pour ses affaires ou ses besoins, et c'est injustement le mauvais effet qui suivrait l'abolition de toute usure ; nous le sentirons mieux par une comparaison.
Je suppose que les propriétaires des maisons n'eussent que le droit de les occuper par eux-mêmes, ou d'y loger d'autres à leur choix, mais toujours sans rien exiger. Qu'arriverait-il de cette nouvelle disposition ? c'est que les propriétaires ne se gêneraient pas pour admettre des locataires dont ils n'auraient que l'incommodité. Ils commenceraient donc par se loger fort au large, et pour le surplus, ils préféreraient leurs parents et leurs amis qui ne se gêneraient pas davantage, et il en résulterait dès-à-présent que bien des gens sans protection coucheraient à la belle étoile. Mais ce serait bien pis dans la suite : les riches contens de se loger commodément, ne bâtiraient plus pour la simple location, et d'ailleurs les maisons actuellement occupées par les petits et les médiocres seraient entretenues au plus mal. Qui voudrait alors se charger des réparations ? serait-ce les propriétaires, qui ne tireraient aucun loyer ? serait-ce les locataires, qui ne seraient pas surs de jouir, et qui souvent ne pourraient faire cette dépense ? On verrait donc bientôt la plus grande partie des édifices dépérir, au point qu'il n'y aurait pas dans quarante ans la moitié des logements nécessaires. Observons encore que tant d'ouvriers employés aux bâtiments se trouveraient presque désœuvrés. Ainsi la plupart des hommes sans gite et même sans travail seraient les beaux fruits des locations gratuites ; voyons ce que la gratuité des prêts nous amenerait.
On voit au premier coup d'oeil, que posé l'abolition de toute usure, peu de gens voudraient s'exposer aux risques inséparables du prêt ; chacun en conséquence garderait ses espèces et voudrait les employer ou les tenir par ses mains ; en un mot, dès que la crainte de perdre ne serait plus balancée par l'espérance de gagner, on ne livrerait plus son argent, et il ne se ferait plus guère sur cela que des espèces d'aumônes, des prêtés-donnés de peu de conséquence et presque jamais des prêts considérables ; combien de fabriques et d'autres sortes d'entreprises, de travaux et de cultures qui se verraient hors d'état de se soutenir, et réduites enfin à l'abandon au grand dommage du public ?
Un charretier avait imaginé d'entretenir quatre chevaux de trait au bas de Saint-Germain, pour faciliter la montée aux voituriers ; il aurait fourni ce secours à peu de frais, et le public en eut bien profité ; mais quelqu'un donna du scrupule à celui qui fournissait l'argent pour cette entreprise. On lui fit entendre qu'il ne pouvait tirer aucun profit d'une somme qu'il n'avait pas aliénée ; il le crut comme un ignorant, et en conséquence il voulut placer ses deniers d'une manière plus licite. Les chevaux dont on avait déjà fait emplette, furent vendus aussi-tôt, et l'établissement n'eut pas lieu.
L'empereur Basile, au neuvième siècle, tenta le chimérique projet d'abolir l'usure, mais Léon le sage, Léon son fils, fut bientôt obligé de remettre les choses sur l'ancien pied. " Le nouveau règlement, dit celui-ci, ne s'est pas trouvé aussi avantageux qu'on l'avait espéré, au contraire, les choses vont plus mal que jamais ; ceux qui prêtaient volontiers auparavant à cause du bénéfice qu'ils y trouvaient, ne veulent plus le faire depuis la suppression de l'usure, et ils sont devenus intraitables ". In eos qui pecuniis indigent, difficiles atque immites sunt, novella Leonis 83.
Léon ne manque pas d'accuser à l'ordinaire la corruption du cœur humain, car c'est toujours lui qui a tort, et on lui impute tous les désordres. Accusons à plus juste titre l'immuable nature de nos besoins, ou l'invincible nécessité de nos communications ; nécessité qui renversera toujours tout ce que l'on s'efforcera d'élever contre elle. Il est en général impossible, il est injuste d'engager un homme à livrer sa fortune au hasard des faillites et des pertes, en prêtant sans indemnité à une personne aisée ; c'est pour cette raison que les intérêts sont au moins tolérés parmi nous dans les emprunts du roi et du clergé, dans ceux de la compagnie des Indes, des fermiers généraux, etc. tandis que les mêmes intérêts, par une inconséquence bizarre, sont défendus dans les affaires qui ne regardent que les particuliers : il en faut pourtant excepter le pays de Bugey et ses dépendances, où l'intérêt est publiquement autorisé en toutes sortes d'affaires. Les provinces qui ressortissent aux parlements de Toulouse et de Grenoble ont un usage presque équivalent, puisque toute obligation sans frais et sans formalité y porte intérêt depuis son échéance.
Réponse aux objections prises du droit naturel. On nous soutient que l'usure est contraire au droit naturel, en ce que la propriété suit, comme l'on croit, l'usage de la somme prêtée. L'argent que nous avons livré, dit-on, ne nous appartient plus ; nous en avons cédé le domaine à un autre, mutuum, idest ex meo tuum. Telle est la raison définitive de nos adversaires. On fait beaucoup valoir ici l'autorité de S. Thomas, de S. Bonaventure, de Gerson, de Scot, etc. Qui mutuat pecuniam, transfert dominium pecuniae, Thom. XXII. quaest. 8. art. 2. In mutuatione pecuniae transfertur pecunia in dominium alienum. Bonav. in 3. senten. dist. 37.
De cette proposition considérée comme principe de morale, on infère que c'est une injustice, une espèce de vol de tirer quelque profit d'une somme qu'on a prêtée ; une telle somme, dit-on, est au pouvoir, comme elle est aux risques de l'emprunteur. L'usage lucratif qu'il en fait, doit être pour son compte ; un tel gain est le fruit de son travail ou de son industrie ; et il n'est pas juste qu'un autre vienne le partager.
De tous les raisonnements que l'on oppose contre l'usure légale, au-moins de ceux qu'on prétend appuyer sur l'équité naturelle, voilà celui qui est regardé comme le plus fort ; néanmoins ce n'est au fond qu'une misérable chicane ; et de telles objections méritent à peine qu'on y réponde. En effet est-ce la prétendue formation du mot mutuum qui peut fixer la nature du prêt et les droits qui en dérivent ? Cela marque tout-au-plus l'opinion qu'en ont eu quelques jurisconsultes chez les Romains ; mais cela ne prouve rien au-delà.
Quoi qu'il en sait, distinguons deux sortes de propriétés : l'une individuelle, qui consiste à posséder, par exemple, cent louis dont on peut disposer de la main à la main ; et une propriété civile, qui consiste dans le droit qu'on a sur ces cent louis, lors même qu'on les a prêtés. Il est bien certain que dans ce dernier cas, on ne conserve plus la propriété individuelle des louis dont on a cédé l'usage, et dont le remboursement se peut faire avec d'autres monnaies ; mais on conserve la propriété civîle sur la somme remise à l'emprunteur, puisqu'on peut la répéter au terme convenu. En un mot, le prêt que je vous fais, est, à parler exactement, l'usage que je vous cede d'un bien qui m'appartient, et qui lors même que vous en jouissez, ne cesse pas de m'appartenir, puisque je puis le passer en payement à un créancier.
Tout roule donc ici du côté de nos adversaires, sur le défaut d'idées claires et précises par rapport à la nature du prêt ; ils soutiennent que l'emprunteur a réellement la propriété de ce qu'on lui prête, au lieu qu'il n'en a que la jouissance ou l'usage. En effet on peut jouir du bien d'autrui à différents titres ; mais on ne saurait en être propriétaire sans l'avoir justement acquis. Les justes manières d'acquérir, sont entr'autres l'échange, l'achat, la donation, etc. Le prêt ne fut jamais regardé comme un moyen d'acquérir ou de s'approprier la chose empruntée, parce qu'il ne nous en procure la jouissance que pour un temps déterminé et à certaines conditions ; en conséquence je conserve toujours la propriété de ce que je vous ai prêté, et de cette propriété constante nait le droit que j'ai de réclamer cette chose en justice, si vous ne me la rendez pas de vous-même après le terme du prêt ; mais si vous me la remettez, dès-lors je rentre dans la possession de ma chose, dès-lors j'en ai la pleine propriété, au lieu que je n'en avais auparavant que la propriété nue : c'est l'expression du droit romain, l. XIX. pr. D. de usuris et fructibus... 21-1, §. ult. inst. de usufructu. 2. 4.
L'argent dont vous jouissez à titre d'emprunt, est donc toujours l'argent d'autrui, c'est-à-dire l'argent du prêteur, puisqu'il en reste toujours le propriétaire. C'est d'où vient cette façon de parler si connue, travailler avec l'argent d'autrui ou sur les fonds d'autrui. Tel était le sentiment des Romains, lorsqu'ils appelaient argent d'autrui, aes alienum, une somme empruntée ou une dette passive. On retrouve la même façon de s'exprimer dans la règle suivante ; notre bien consiste en ce qui nous reste après la déduction de nos dettes passives, ou pour parler comme eux, après la déduction de l'argent d'autrui. Bona intelliguntur cujusque quae deducto aere alieno supersunt. lib. XXXIX. §. 1. D. de verborum significatione, l. XI. de jure fisci. 49-14.
Mais observons ici une contradiction manifeste de la part de nos adversaires. Après avoir établi de leur mieux que la propriété d'une somme prêtée appartient à l'emprunteur, que par conséquent c'est une injustice au créancier d'en tirer un profit, puisque c'est, disent ils, profiter sur un bien qui n'est plus à lui ; la force du sentiment et de la vérité leur fait si bien oublier cette première assertion, qu'ils admettent ensuite la proposition contradictoire ; qu'ils soutiennent en un mot que l'argent n'est pas aliéné par le prêt pur et simple, et que par conséquent il ne saurait produire un juste intérêt : c'est même ce qui leur a fait imaginer le contrat de constitution, ou comme l'on dit en quelques provinces, le constitut, au moyen duquel le débiteur d'une somme aliénée devenant maître du fond, en paie, comme on l'assure, un intérêt légitime. Mais voyons la contradiction formelle dans les conférences ecclésiastiques du père Semelier et dans le dictionnaire de Pontas : contradiction du reste qui leur est commune avec tous ceux qui rejettent le prêt de commerce.
Le premier nous assure " que selon Justinien, suivi, dit-il, en cela par S. Thomas, Scot et tous les théologiens, il se fait par le simple prêt une véritable aliénation de la propriété aussi bien que de la chose prêtée, in hoc damus ut accipientium fiant ; en sorte que celui qui la prête, cesse d'en être le maître. ". Conf. eccl. tom. I. pag. 6.
" L'argent prêté, dit-il encore, est tout au marchand, c'est-à-dire, à l'emprunteur, dès qu'il en répond ; et s'il est au marchand, c'est pour lui seul qu'il doit profiter.... Res perit domino, res fructificat domino ". Ibid. p. 319. C'est par ce principe, comme nous l'avons dit, qu'ils tâchent de prouver l'iniquitté de l'usure. Mais ce qui montre bien que cette doctrine est moins appuyée sur l'évidence et la raison que sur des subtilités scolastiques, c'est que les théologiens l'oublient dès qu'ils n'en ont plus besoin.
Le père Semelier lui-même, ce savant rédacteur des conférences de Paris, en est un bel exemple. Voici comme il se dédit dans le même volume, pag. 237. " Quand je prête, dit-il, mes deniers, le débiteur est tenu de m'en rendre la valeur à l'échéance de son billet ; il n'y a donc pas de véritable aliénation dans les prêts ".
De même parlant d'un créancier qui se fait adjuger des intérêts par sentence, quoiqu'il ne souffre pas de la privation de son argent, il s'explique en ces termes, page 390 : " il n'a, dit-il, en vue que de s'autoriser à percevoir sans titre et sans raison, un gain et un profit de son argent, sans néanmoins l'avoir aliéné ".
Remarquons encore le mot qui suit : " dire qu'il y a une aliénation pour un an dans le prêt qu'on fait pour an, c'est, disent les prélats de France, assemblée de 1700, abuser du mot d'aliénation, c'est aller contre tous les principes du droit ". Ibid. p. 235.
" Il est constant et incontestable, dit Pontas, que celui qui prête son argent, en transfère la propriété à celui qui l'emprunte, et qu'il n'a par conséquent aucun droit au profit que celui-ci en retire, parce qu'il le retire de ses propres deniers ". Ce casuiste s'autorise, comme le premier, des passages de S. Thomas ; mais après avoir assuré, comme nous voyons, la propriété de la somme prêtée à l'emprunteur, page de son dictionnaire 1372, il ne s'en souvient plus à la page suivante. " Il est certain, dit-il, qu'Othon ne peut sans usure, c'est-à-dire ici sans injustice, exiger un intérêt ; car quoiqu'il se soit engagé de ne répéter que dans le terme de trois ans, la somme qu'il a prêtée à Silvain, il ne peut pas être censé l'avoir aliénée. La raison en est qu'il est toujours vrai de dire qu'il la pourra répéter au terme échu, ce qui ne serait pas en son pouvoir, s'il y avait une aliénation réelle et véritable ".
Après des contradictions si bien avérées, et dont je trouverais cent exemples, peut-on nous opposer encore l'autorité des casuistes ?
Les légistes sont aussi en contradiction avec eux-mêmes sur l'article de l'usure, et je le montrerai dans la suite. Je me contente d'exposer à-présent ce qu'ils disent de favorable à ma thèse. Ils reconnaissent qu'on peut léguer une somme à quelqu'un, à condition qu'un autre en aura l'usufruit et que l'usage par conséquent n'emporte pas la propriété. Si tibi decem millia legata fuerint, mihi eorumdem decem millium ususfructus, fient quidem tua tota decem millia. L. VI. in princip. D. de usufructu earum rerum. 7-5.
" Si vous ayant légué dix mille écus, on m'en laissait l'usufruit, ces dix mille écus vous appartiendraient en propriété ". On voit donc en effet que la somme qui doit passer pour un temps à l'usufruitier, appartient réellement au légataire, fient quidem tua tota, et il en a si bien le vrai domaine, qu'il peut, comme on l'a dit, le transporter à un autre. C'est donc perdre de vue les principes les plus communs, ou plutôt c'est confondre des objets très-différents, que de disputer la propriété à celui qui prête ; car, comme nous l'avons observé, dès qu'on ne peut lui contester le droit de réclamer ce qu'il a prêté, c'est convenir qu'il en a toujours été le propriétaire, qualité que la raison lui conserve, comme la loi positive. Qui actionem habet ad rem recuperandam, ipsam rem habere videtur, l. XV. D. de regulis juris.
Et quand même pour éviter la dispute, on abandonnerait cette dénomination de propriété à l'égard du prêteur ; il est toujours vrai qu'au moment qu'il a livré, par exemple, ses cent louis, il en était constamment le propriétaire, et qu'il ne les a livrés qu'en recevant une obligation de pareille valeur, à la charge de l'usure légale et compensatoire ; condition sincèrement agréée par l'emprunteur, et qui par conséquent devient juste, puisque volenti non fit injuria, condition du reste qui ne lui est point onéreuse, d'autant qu'elle est proportionnée aux produits des fonds et du négoce ; d'où j'infère que c'est un commerce d'utilités réciproques, et qui mérite toute la protection des lois.
Sur ce qu'on dit que l'argent est stérile, et qu'il périt au premier usage qu'on en fait, je réponds que ce sont-là de vaines subtilités démenties depuis longtemps par les négociations constantes de la société. L'argent n'est pas plus stérîle entre les mains d'un emprunteur qui en fait bon usage, qu'entre les mains d'un commis habîle qui l'emploie pour le bien de ses commettants. Aussi Justinien a-t-il évité cette erreur inexcusable, lorsque parlant des choses qui se consument par l'usage, il a dit simplement de l'argent comptant, quibus proxima est pecunia numerata, namque ipso usu assiduâ permutatione, quodammodo extinguitur ; sed utilitatis causâ senatus censuit posse etiam earum rerum usum fructum constitui. §. 2. inst. de usufructu. 2-4.
Il est donc certain que l'argent n'est point détruit par les échanges, qu'il est représenté par les fonds ou par les effets qu'on acquiert, en un mot, qu'il ne se consume dans la société que comme les grains se consument dans une terre qui les reproduit avec avantage.
Quant à la stérilité de l'argent, ce n'est qu'un conte puérile. Cette prétendue stérilité disparait en plusieurs cas, de l'aveu de nos adversaires. Qu'un gendre, par exemple, à qui l'on donne vingt mille francs pour la dot de sa femme, mais qui n'a pas occasion de les employer, les laisse pour un temps entre les mains de son beau-pere, personne ne conteste au premier le droit d'en toucher l'intérêt, quoique le capital n'en soit pas aliéné. Ces vingt mille francs deviennent-ils féconds, parce qu'on les appelle deniers dotaux ? Et si le beau-pere avait eu d'ailleurs une pareille somme, pourrait-on croire sérieusement qu'elle fût en soi moins fructueuse, moins susceptible d'intérêt ? Qu'une somme inaliénée vienne d'un gendre ou d'un étranger, elle ne change pas de nature par ces circonstances accidentelles ; et si l'excellente raison d'un ménage à soutenir autorise ici le gendre à recevoir l'intérêt de la dot, cette raison aura la même force à l'égard de tout autre citoyen. De même une sentence qui adjuge des intérêts, n'a pas la vertu magique de rendre une somme d'argent plus féconde ; cette somme demeure physiquement telle qu'elle était auparavant.
A l'égard des risques du preneur, rien de plus équitable, puisqu'il emprunte à cette condition. Celui qui loue des meubles et à qui on les vole, celui qui prend une ferme et qui s'y ruine, celui qui loue une maison pour une entreprise où il échoue, tous ces gens-là ne supportent-ils pas les risques, sans que leurs malheurs ou leur imprudence les déchargent de leurs engagements. D'ailleurs on fait souvent de ce qu'on emprunte un emploi fructueux qui ne suppose proprement ni risque ni travail. Quand j'achète, par exemple, au moyen d'un emprunt, tel papier commerçable, telle charge sans exercice, etc. je me fais sans peine un revenu, un état avantageux avec l'argent d'autrui, aere alieno. Quoi l'on ne trouve pas mauvais que j'use du produit d'une somme qui ne m'appartient pas, et l'on trouve mauvais que le propriétaire en tire un modique avantage ! Que devient donc l'équité ? Qui est-ce qui dédommagera le créancier de la privation de son argent, et des risques de l'insolvabilité ? Car si l'on y fait attention, l'on verra que c'est principalement sur lui que tombent les faillites et les pertes ; de sorte que le res perit domino n'est encore ici que trop véritable à son égard.
D'un autre côté, que l'emprunteur ne fasse valoir l'argent d'autrui qu'à l'aide de son industrie, il est également juste que le bailleur ait part au bénéfice ; et l'on ne voit encore ici que de l'égalité, puisque l'emprunteur profite lui-même des cinquante années de travail et d'épargne qui ont enfanté les sommes qu'on lui a livrées, et qui ont rendu fructueuse une industrie, toute seule insuffisante pour les grandes entreprises. Réflexion qui découvre le peu de fondement du reproche que S. Grégoire de Nazianze fait à l'usurier, en lui objectant qu'il recueille où il n'a point semé, colligens ubi non seminarat. Orat. 15.
En effet celui-ci peut répondre avec beaucoup de justesse et de vérité, qu'il seme dans le commerce usuraire et son industrie et celle de ses ancêtres, en livrant des sommes considérables, qui en sont le fruit tardif et pénible.
On nous suppose encore l'autorité d'Aristote, et l'on nous dit avec cet ancien philosophe, que l'argent n'est pas destiné à procurer des gains ; qu'il n'est établi dans le commerce que pour en faciliter les opérations ; et que c'est intervertir l'ordre et la destination des choses, que de lui faire produire des intérêts.
Sur quoi, je dis qu'il n'y a point de mal à étendre la destination primitive des espèces ; elles ont été inventées, il est vrai, pour la facilité des échanges, usage qui est encore le plus ordinaire aujourd'hui ; mais on y a joint un grand bien de la société, celui de produire des intérêts, à-peu-près comme on a donné de l'extension à l'usage des maisons et des voitures qui n'étaient pas destinées d'abord à devenir des moyens de lucre. C'est ainsi que le premier qui inventa les chaises pour s'asseoir, n'imaginait pas qu'elles dussent être un objet de location dans nos églises. Toutes ces pratiques se sont introduites dans le monde, à-mesure que les circonstances et les besoins ont étendu le commerce entre les hommes, et que ces extensions se sont trouvées respectivement avantageuses.
On objecte enfin qu'il est aisé de faire valoir son argent au moyen des rentes constituées ; sans recourir à des pratiques réputées criminelles. A quoi je réponds que cette forme de contrat n'est qu'un palliatif de l'usure. Si l'intérêt qu'on tire par cette voie devient onéreux au pauvre, une tournure différente ne le rendra pas légitime. C'est aussi le sentiment du père Semelier, Conf. ecclés. p. 21. Une telle pratique, dispendieuse pour l'emprunteur, n'est bonne en effet que pour éluder l'obligation de secourir le malheureux ; mais le précepte reste le même, et il n'est point de subtilité capable d'altérer une loi divine si bien entée sur la loi naturelle.
Les rentes constituées sur les riches sont à la vérité des plus licites ; mais on sait que ce contrat est insuffisant. Les gens pécunieux ne veulent pas d'ordinaire livrer leur argent sans pouvoir le répeter dans la suite, parce qu'ayant des vues ou des projets pour l'avenir, ils craignent d'aliéner des fonds dont ils veulent se réserver l'usage ; aussi est-il constant qu'on ne trouve guère d'argent par cette voie, et que c'est une faible ressource pour les besoins de la société.
Les trois contrats. En discutant la question de l'usure, suivant les principes du droit naturel, je ne puis guère me dispenser de dire un mot sur ce qu'on appelle communément les trois contrats.
C'est proprement une négociation ou plutôt une fiction subtilement imaginée pour assurer le profit ordinaire de l'argent prêté, sans encourir le blâme d'injustice ou d'usure : car ces deux termes sont synonymes dans la bouche de nos adversaires. Voici le cas.
Paul confie, par exemple, dix mille livres à un négociant, à titre d'association dans telle entreprise ou tel commerce ; voilà un premier contrat qui n'a rien d'illicite, tant qu'on y suit les règles. Paul quelque temps après inquiet sur sa mise, cherche quelqu'un qui veuille la lui assurer ; le même négociant qui a reçu les fonds, ou quelqu'autre si l'on veut, instruit que les dix mille francs sont employés dans une bonne affaire, assure à Paul son capital, posons à un pour cent par année, et chacun parait content. Voilà un deuxième contrat, qui n'est pas moins licite que le premier.
Cependant quelqu'espérance que l'on fasse concevoir à Paul de son association, qui lui vaudra, diton, plus de douze pour cent, année commune, il considère toujours l'incertitude des événements ; et se rappelant les pertes qu'il a souvent essuyées nonobstant les plus belles apparences, il propose de céder les profits futurs à des conditions raisonnables, posons à six pour cent par année ; ce qui lui ferait, l'assurance du fonds payée, cinq pour cent de bénéfice moralement certain. Le négociant qui assure déjà le capital, accepte de même ce nouvel arrangement ; et c'est ce qui fait le troisième contrat, lequel est encore permis, pourvu, dit-on, que tout cela se fasse de bonne foi et sans intention d'usure ; car on veut toujours diriger nos pensées.
Dans la suite le même négociant ou autre particulier quelconque dit à notre prêteur pécunieux ; sans tant de cérémonies, si vous voulez, je vous assurerai dès le premier jour votre principal et tout ensemble un profit honnête de cinq pour cent par année ; le créancier goute cette proposition et l'accepte ; et c'est ce qu'on nomme la pratique des trois contrats ; parce qu'il en résulte le même effet, que si après avoir passé un contrat de société, on en faisait ensuite deux autres, l'un pour assurer le fonds, et l'autre pour assurer les bénéfices.
Les casuistes conviennent que ces trois contrats, s'ils sont séparément pris et faits en divers temps sont d'eux-mêmes très-licites, et qu'ils se font tous les jours en toute légalité. Mais, dit-on, si on les fait en même temps ; c'est dès-lors une usure palliée ; et dès-là ces stipulations deviennent injustes et criminelles. Toute la preuve qu'on en donne, c'est qu'elles se réduisent au prêt de commerce dont elles ne diffèrent que par la forme. Il est visible que c'est-là une pétition de principe, puisqu'on emploie pour preuve ce qui fait le sujet de la question, je veux dire l'iniquitté prétendue de tout négoce usuraire. On devrait considérer plutôt que l'interposition des temps qu'on exige entre ces actes, n'y met aucune perfection de plus ; et qu'enfin ils doivent être censés légitimes, dès-là, que toutes les parties y trouvent leur avantage. Ainsi, au-lieu de fonder l'injustice de ces contrats, sur ce que l'usage qu'on en fait conduit à l'usure, ou pour mieux dire, s'identifie avec elle, il faudrait au-contraire prouver la justice de l'usure légale par l'équité reconnue des trois contrats, dont la légitimité n'est pas dû. à quelques jours ou quelques mois que l'on peut mettre entre eux, mais à l'utilité qui en résulte pour les contractants.
Au surplus, comme nous admettons sans détour l'usure ou l'intérêt légal, et que nous en avons démontré la conformité avec le droit naturel, nous n'avons aucun besoin de recourir à ces fictions futiles.
Arrêtons-nous ici un moment, et rassemblons sous un point de vue les principes qui démontrent l'équité de l'usure légale entre gens aisés ; et les avantages de cette pratique pour les sociétés policées.
Rien de plus juste que les conventions faites de part et d'autre, librement et de bonne foi ; et rien de plus équitable que l'accomplissement de promesses où chaque partie trouve son avantage. C'est-là, comme nous l'avons observé, la pierre de touche de la justice.
Nul homme n'a droit à la jouissance du bien d'un autre, s'il n'a fait agréer auparavant quelque sorte de compensation : un homme aisé n'a pas plus de droit à l'argent de son voisin, qu'à son bœuf ou son âne, sa femme ou sa servante ; ainsi rien de plus juste que d'exiger quelqu'indemnité, en cédant pour un temps le produit de son industrie ou de ses épargnes, à un homme à l'aise qui augmente par-là son aisance.
Rien de plus fructueux dans l'état que cette équitable communication entre gens aisés, pourvu que le prêt qui en est le moyen, offre des avantages à toutes les parties. De-là nait la circulation qui met en œuvre l'industrie ; et l'industrie employant à son tour l'indigence, ses œuvres raniment tant de membres engourdis, qui sans cela, devenaient inutiles.
Le délire de la plupart des gouvernements, dit un célèbre moderne, fut de se croire préposés à tout faire, et d'agir en conséquence. C'est par une suite de cette persuasion si ordinaire aux législateurs, qu'au-lieu de laisser une entière liberté sur le commerce usuraire, comme sur le commerce de la laine, du beurre et du fromage, au-lieu de se reposer à cet égard sur l'équilibre moral, déjà bien capable de maintenir l'égalité entre les contractants ; ils ont cru devoir faire un prix annuel pour la jouissance de l'argent d'autrui. Cette fixation est devenue une loi dans chaque état, et c'est ce prix connu et déterminé, que nous appelons usure légale ; fruit civil ou légitime acquis au créancier, comme une indemnité raisonnable de l'usage qu'il donne de son argent à un emprunteur qui en use à son profit.
C'est ainsi que les hommes en cherchant leurs propres avantages avec la modération prescrite par la loi, et qui serait peut-être assez balancée par un conflit d'intérêts, entretiennent sans y penser, une réciprocation de services et d'utilités qui fait le vrai soutien du corps politique.
Montrons à-présent que nous n'avons rien avancé jusqu'ici qui ne soit conforme à la doctrine des casuistes.
C'est une maxime constante dans la morale chrétienne, qu'on peut recevoir l'intérêt d'une somme, toutes les fois que le prêt qu'on en fait entraîne un profit cessant ou un dommage naissant, lucrum cessants aut damnum emergens. Par exemple, Pierre expose à Paul qu'il a besoin de mille écus pour terminer une affaire importante. Paul répond que son argent est placé dans les fonds publics, ou que s'il ne l'est pas actuellement, il est en parole pour en faire un emploi très-avantageux ; ou qu'enfin il en a besoin lui-même pour réparer des bâtiments qui ne se loueraient pas sans cela. Pierre alors fait de nouvelles instances pour montrer le cas pressant où il se trouve, et détermine Paul à lui laisser son argent pendant quelques années, à la charge, comme de raison, d'en payer l'intérêt légal.
Dans ces circonstances les casuistes reconnaissent unanimement le lucre cessant ou le dommage naissant ; et conviennent que Paul est en droit d'exiger de Pierre l'intérêt légal ; et cet intérêt, disent-ils, n'est pas usuraire ; ou, comme ils l'entendent, n'est pas injuste. Consultez entr'autres le père Sémelier dont l'ouvrage surchargé d'approbations, est proprement le résultat des conférences ecclésiastiques tenues à Paris sous le cardinal de Noailles, c'est-à-dire, pendant le règne de la saine et savante morale.
" Si les intérêts, dit-il, sont prohibés, les dédommagements bien loin d'être défendus, sont ordonnés par la loi naturelle, qui veut qu'on dédommage ceux qui souffrent pour nous avoir prêté. Conf. ecclés. p. 254. Les saints pères.... saint Augustin entr'autres, dans sa lettre à Macédonius, ont expliqué les règles de la justice que les hommes se doivent rendre mutuellement. N'ont-ils pas enseigné après Jésus-Christ qu'ils doivent se traiter les uns les autres, comme ils souhaitent qu'on les traite eux-mêmes, et qu'ils ne doivent ni refuser, ni faire à leurs frères ce qu'ils ne voudraient pas qu'on leur refusât ni qu'on leur fit. Or cette règle si juste n'est-elle pas violée, si je n'indemnise pas celui qui en me prêtant, sans y être obligé, se prive d'un gain moralement certain, etc. " Ibid. p. 280.
On lit encore au même volume, " que quand pour avoir prêté on manque un gain probable et prochain, le lucre cessant est un titre légitime ; vérité, dit le conférencier, reconnue par les plus anciens canonistes Ancaranus, Panorme, Gabriel, Adrien VI. etc. qui tous forment une chaîne de tradition depuis plusieurs siècles, et autorisent le titre du lucre cessant.... Ces canonistes si éclairés ont été suivis, dit-il, dans cette décision par les évêques de Cahors et de Châlons.... par les théologiens de Grenoble, de Périgueux, de Poitiers, etc. " Ibid. p. 285.
S. Thomas reconnait aussi que celui qui prête peut stipuler un intérêt de compensation à cause de la perte qu'il fait en prêtant, lorsque par-là il se prive d'un gain qu'il devait faire ; car, dit-il, ce n'est pas là vendre l'usage de son argent, ce n'est qu'éviter un dommage. Ille qui mutuum dat, potest absque peccato in pactum deducère cum eo qui mutuum accipit, récompensationem damni, per quod substrahitur sibi aliquid quod debet habere ; hoc enim non est vendere usum pecuniae, sed damnum vitare, II. IIe quaest. lxxxviij. art. 2. Ou comme dit saint Antonin, parlant de celui qui paye avant terme, et qui retient l'escompte, tunc non est usura, quia nullum ex hoc lucrum consequitur, sed solum conservant se indemnem. Secunda parte summae theol. tit. 1. cap. VIIIe
Je conclus de ces propositions que tous ceux qui prêtent à des gens aisés sont dans le cas du lucre cessant ou du dommage naissant. En effet, à qui peut-on dire le mot de S. Ambraise, prosit alii pecunia quae tibi otiosa est ? Où est l'homme qui ne cherche à profiter de son bien, et qui n'ait pour cela des moyens moralement surs ? S'il était cependant possible qu'un homme se trouvât dans l'étrange hypothèse que fait ce père, nous conviendrions volontiers que s'il prêtait, il devrait le faire sans intérêt ; mais en général tout prêteur peut dire à celui qui emprunte, en vous remettant mon argent, je vous donne la préférence sur les fonds publics, sur l'hôtel de ville, les pays d'états, la compagnie des Indes, etc. sur le commerce que je pourrais faire, je néglige enfin pour vous obliger des gains dont j'ai une certitude morale ; en un mot je suis dans le cas du lucre cessant, puisque, selon l'expression de S. Thomas, vous m'ôtez un profit que j'avais déjà, ou que vous empêchez celui que j'allais faire, mihi aufers quod actu habebam aut impedis ne adipiscar quod eram in via habendi. II. IIe quaest. 64. art. 4. Il est donc juste que vous m'accordiez l'intérêt honnête que je trouverais ailleurs.
Cette vérité est à la portée des moindres esprits ; aussi s'est-elle fait jours au-travers des préjugés contraires, et c'est pour cela qu'on admet l'intérêt dans les emprunts publics, de même que dans les négociations de banque et d'escompte ; en sorte qu'il n'est pas convenable qu'on ose encore attaquer notre proposition. Mais il est bien moins concevable que S. Thomas se mette là-dessus en contradiction avec lui-même ; c'est pourtant ce qu'il fait d'une manière bien sensible, surtout dans une réponse à Jacques de Viterbe qui l'avait consulté sur cette matière ; car oubliant ce qu'il établit si-bien en faveur de l'intérêt compensatoire qu'il appelle récompensationem damni, il déclare expressément que le dommage qui nait d'un payement fait avant terme n'autorise point à retenir l'escompte ou l'intérêt, par la raison, dit-il, qu'il n'y a pas d'usure qu'on ne put excuser sur ce prétexte ; nec excusatur per hoc quod solvendo ante terminum gravatur.... quia eâdem ratione possent usurarii excusari omnes. Mais laissons ce grand docteur s'accorder avec lui-même et avec S. Antonin ; et voyons enfin à quoi se réduit la gratuité du prêt telle qu'elle est prescrite en général par les théologiens.
Quelqu'un, je le suppose, vous demande vingt mille francs à titre d'emprunt ; on avoue que vous n'êtes pas tenu de les prêter ; mais suivant la doctrine de l'école, supposé que vous acceptiez la proposition, vous devez prêter la somme sans en exiger d'intérêts ; car si vous vendiez, dit-on, l'usage d'une somme que vous livrez pour un temps, ce serait de votre part un profit illicite et honteux, une usure, un vol, un brigandage, un meurtre, un parricide ; expressions de nos adversaires que je copie fidèlement : en un mot, vous ne pouvez recevoir aucun intérêt quoique vous prêtiez pour un temps considérable, quand vous ne demanderiez qu'un pour cent par année. L'usure est, disent-ils, tout ce qui augmente le principal, usura est omnis accessio ad sortem. Cependant il vous reste une ressource consolante : comme vos vingt mille francs font une grande partie de votre fortune et qu'ils vous sont nécessaires pour les besoins de votre famille ; que d'un autre côté vous ne manquez pas d'occasion d'en tirer un profit légitime, et qu'enfin vous êtes toujours comme parle S. Thomas in viâ habendi, vous pouvez sans difficulté recevoir l'intérêt légal, non pas, encore un coup, à titre de lucre, non pas en vertu du prêt qui doit être gratuit, dit-on, pour qu'il ne soit pas injuste ; conf. p. 383. en le prenant ainsi tout serait perdu ; Dieu serait griévement offensé, l'emprunteur serait lésé, volé, massacré. Mais rappelez-vous seulement le cas où vous êtes du lucre cessant ; et au lieu d'exiger un profit en vertu du prêt, ne l'exigez qu'à titre d'indemnité, titulo lucri cessantis : dès-lors tout rentre dans l'ordre, toute justice s'accomplit, et les théologiens sont satisfaits. Tant il est vrai qu'il n'y a qu'à s'entendre pour être bientôt d'accord. En effet il faudrait être bien dépravé pour se rendre coupable d'usure en imputant le bénéfice du prêt au prêt même, tandis qu'il est aisé par un retour d'intention, de rendre tout cela bien légitime.
Le dirai-je, sans faire tort à nos adversaires ? Je les trouve en général plus ardents pour soutenir leurs opinions, que zélés pour découvrir la vérité. Je les vois d'ailleurs toujours circonscrits dans un petit cercle d'idées et de mots ; si bien aveuglés enfin par les préjugés de l'éducation, qu'ils ne connaissent ni la nature du juste et de l'injuste, ni la destination primitive des lois, ni l'art de raisonner conséquemment. Qu'il me soit permis de leur demander si les plus grands ennemis de l'usure sont dans l'usage de prêter gratis la moitié ou les trois quarts de leur bien ; s'il est une famille dans le monde, une église, corps ou communauté, qui prête habituellement de grandes sommes, sans se ménager aucun profit ? Il n'en est point ou il n'en est guère ; alligant onera gravia et importabilia et imponunt in humeros hominum, digito autem suo nolunt ea movère. Matt. xxiij. 4. Le désintéressement n'est que pour le discours ; dès qu'il est question de la pratique, les plus zélés veulent profiter de leurs avantages. Tout le monde crie contre l'usure, et tout le monde est usurier : je l'ai prouvé ci-devant, et je vais le prouver encore.
On est, dit-on, coupable d'usure dès qu'on reçoit plus qu'on ne donne ; ce qui ne s'entend d'ordinaire que de l'argent prêté. Cependant la gratuité du prêt ne se borne pas là. Moïse dit de la part de Dieu : vous ne tirerez aucun intérêt de votre frère, soit que vous lui prêtiez de l'argent, du grain ou quelque autre chose que ce puisse être. Non foenerabis fratri tuo ad usuram pecuniam, nec fruges nec quamlibet aliam rem. Deut. xxiij. 19. Il s'explique encore plus positivement au même endroit, en disant : vous prêterez à votre frère ce dont il aura besoin, et cela sans exiger d'intérêt. Fratri tuo absque usurâ id quod indiget commodabis. Donnez, dit le Sauveur, à celui qui vous demande, et ne rejetez point la prière de celui qui veut emprunter ; qui petit à te da ei, et volenti mutuari ne à te avertaris. Matt. 5. 42.
Mais si ces maximes sont autant de préceptes, comme le prétendent nos adversaires, qui d'eux et de nous n'aura pas quelque usure à se reprocher ? qui d'entr'eux n'exige pas les dimes, les cens et rentes que leur paient des malheureux hors d'état souvent d'y satisfaire ? Qui d'entr'eux ne loue pas quelque portion de terre, quelque logement ou dépendances à de pauvres gens embarrassés pour le payement du loyer ? Qui d'entr'eux ne congédie pas un locataire insolvable ? Est-ce là être fidèle à ces grandes règles, fratri tuo absque usurâ id quo indiget commodabis ; qui petit à te da ei, et volenti mutuari, à te ne avertaris.
Qu'on ne dise pas que je confonds ici la location avec le simple prêt. En effet, l'intention de Dieu qui nous est manifestée dans l'Ecriture, est que nous traitions notre prochain, surtout s'il est dans la détresse, comme notre frère et notre ami, comme nous demanderions en pareil cas d'être traités nous-mêmes ; qu'ainsi nous lui prêtions gratis dans son besoin de l'argent, du grain, des habits et toute autre chose, quamlibet aliam rem, dit le texte sacré, par-conséquent un gite quand il sera nécessaire. Il est dit au Lévitique, xxv. 35. craignez votre Dieu, et que votre frère trouve un asîle auprès de vous, time Deum tuum ut vivère possit frater tuus apud te. Tout cela ne comprend-il que le prêt d'argent ? et de telles règles d'une bienfaisance générale n'embrassent-elles point la location gratuite ? L'homme de bien pénétré de ces maximes, exigera-t-il le loyer d'un frère qui a d'ailleurs de la peine à vivre ? Il est dit encore au Deutéronome, XVe 7. Dabis ei, nec ages quidquam callidè in ejus necessitatibus sublevandis ; point de raisons ou de prétextes à opposer de la part de l'homme riche pour esquiver l'obligation de secourir le malheureux ; que ce soit par un prêt, par une location ou par un don pur et simple, c'est tout un : dabis ei, nec ages quidpiam callidè in ejus necessitatibus sublevandis.
Votre frère a besoin de ce morceau de terre, de ce petit jardin ; il a besoin de cette chaumière ou de cette chambre que vous n'occupez pas au quatrième ; il vous demande cela gratis, parce qu'il est dans la détresse et dans l'affliction, et quand vous lui en accorderez pour un temps l'usage ou le prêt gratuit, cette petite générosité ne vous empêchera pas de vivre à l'aise au moyen des ressources que vous avez ailleurs. Cependant vous ne lui accordez pas cet usage absque usurâ ; vous en demandez le prix ou le loyer, le cens ou la rente ; vous l'exigez même à la rigueur, et vous congédiez le malheureux, s'il manque de satisfaire ; peut-être vendez-vous ses meubles, ou vous ou vos ayans cause, car tout cela revient au même. Est-ce là traiter votre prochain comme votre frère, ou plutôt fut-il jamais d'usure plus criante ? Ne trouveriez-vous pas bien dur, si vous étiez vous-même dans la misere, qu'un frère dans l'aisance et dans l'élévation oubliât pour vous les maximes de l'Ecriture et les sentiments de l'humanité ? et ne sentez-vous pas enfin que celui qui tire des intérêts modiques du négociant et de l'homme aisé, est infiniment moins blâmable, moins dur, et moins usurier que vous ?
Quoi qu'il en sait, nous l'avons dit ci-devant des princes législateurs, nous dirons encore mieux de l'être suprême, qu'il n'a pas donné des lois aux hommes pour le plaisir de leur commander ; il l'a fait pour les rendre plus justes ou, pour mieux dire, plus heureux. C'est ainsi qu'en défendant l'usure aux Israélites dans les cas exprimés au texte sacré, il visait sans doute au bien de ce peuple unique qu'il protégeait particulièrement, et auquel il donna des règlements favorables qui ne se sont pas perpétués jusqu'à nous. Cependant si pour faire le bien de tant de peuples moins favorisés, Dieu leur avait interdit l'usure en général, même, comme on prétend, vis-à-vis des riches, il aurait pris une mauvaise voie pour arriver à son but, il l'aurait manqué comme l'empereur Basile, en ce qu'il aurait rendu les prêts si difficiles et si rares, que loin de diminuer nos maux, il aurait augmenté nos miseres.
Heureusement la nécessité de nos communications a maintenu l'ordre naturel et indispensable ; en sorte que malgré l'opinion et le préjugé, malgré tant de barrières opposées en divers temps au prêt lucratif, la juste balance du commerce, ou la loi constante de l'équilibre moral, s'est toujours rendue la plus forte et a toujours fait le vrai bien de la société. Elle a trouvé enfin l'heureux moyen d'éviter le blâme d'une usure odieuse ; et dès-là contente de l'essentiel qu'on lui accorde, je veux dire l'intérêt compensatoire, le récompensationem damni de S. Thomas, elle abandonne le reste aux discussions de l'école, et laisse les esprits inconséquents disputer sur des mots.
Monts de piété. Les monts de piété sont des établissements fort communs en Italie, et qui sont faits avec l'approbation des papes, qui paraissent même autorisés par le concîle de Trente, sess. XXII. Du reste, ce sont des caisses publiques où les pauvres et autres gens embarrassés, vont emprunter à intérêt et sur gages.
Ces monts de piété ne sont pas usuraires, dit le P. Semelier ; notez bien les raisons qu'il en donne. " Ces monts de piété, dit-il, ne sont pas usuraires, si l'on veut faire attention à toutes les conditions qui s'observent dans ces sortes de prêts.
La première, qu'on n'y prête que de certaines sommes, et que pour un temps qui ne passe jamais un an, afin qu'il y ait toujours des fonds dans la caisse. La seconde, qu'on n'y prête que sur gages, parce que comme on n'y prête qu'à des pauvres, le fonds de ces monts de piété seraient bientôt épuisés, si l'on ne prenait pas cette précaution.... La troisième, que quand le temps prescrit pour le payement de ce qu'on a emprunté est arrivé, si celui qui a emprunté ne paye pas, on vend les gages ; et de la somme qui en revient on en prend ce qui est dû au mont de piété, et le reste se rend à qui le gage appartient. La quatrième condition est, qu'outre la somme principale qu'on rend au mont de piété, on avoue qu'on y paye encore une certaine somme. " Conf. p. 299.
Toutes ces dispositions, comme l'on voit, portent le caractère d'une usure odieuse ; on ne prête, dit-on, qu'à des pauvres ; on leur prête sur gages, par conséquent sans risques. On leur prête pour un terme assez court ; et faute de payement à l'échéance, on vend sans pitié, mais non sans perte, le gage de ces misérables : enfin l'on tire des intérêts plus ou moins forts d'une somme inaliénée. Si, comme on nous l'assure, ces pratiques sont utiles et légitimes, et peut-être le sont-elles à bien des égards, l'intérêt légal que nous soutenons l'est infiniment davantage ; il l'est même d'autant plus, que la cause du pauvre y est absolument étrangère.
Notre auteur avoue qu'il se peut glisser " des abus dans les monts de piété ; mais cela n'empêche pas, dit-il, que ces monts, si on les considère dans le but de leur établissement, ne soient très-justes et exemts d'usure. "
Si l'on considère aussi les prêts lucratifs, dans le but d'utilité que s'y proposent tant les bailleurs que les preneurs, quelques abus qui peuvent s'y glisser n'empêcheront pas que la pratique n'en soit juste et exempte d'usure.
Du reste, voici le principal abus qu'on appréhende pour les monts de piété, qu'on appelle aussi Lombards. On craint beaucoup que les usuriers n'y placent des sommes sans les aliéner ; et c'est ce que l'on empêche autant que l'on peut, en n'y recevant guère que des sommes à constitution de rente ; ce qui éloigne, dit le P. Semelier, tous les soupçons que l'on forme contre cet établissement, de donner lieu aux usuriers de prêter à intérêt.
Mais qu'importe au pauvre qui emprunte au mont de piété, que l'argent qu'il en tire, vienne d'un constituant, plutôt que d'un prêteur à terme. Sa condition en est-elle moins dure ? Sera-t-il moins tenu de payer un intérêt souvent plus que légal, à gens impitoyables, qui ne donneront point de repit ; qui faute de payement vendront le gage sans quartier, et causeront tout-à-coup trente pour cent de perte à l'emprunteur ? combien d'usuriers qui sont plus traitables ! L'avantage du pauvre qui a recours au Lombard, étant d'y trouver de l'argent au moindre prix que faire se peut, au-lieu d'insister dans un tel établissement pour avoir de l'argent de constitution, il serait plus utîle pour le pauvre de n'y admettre s'il était possible, que des sommes prêtées à terme, par la raison qu'un tel argent est moins cher et plus facîle à trouver. Mais, dit-on, c'est que l'un est bon et que l'autre est mauvais, c'est que l'un est permis, et que l'autre est défendu. Comme si le bien et le mal en matière de négoce, ne dépendait que de nos opinions ; comme si en ce genre, le plus et le moins de nuisance ou d'utilité, n'étaient pas la raison constituante, et la mesure invariable du juste et de l'injuste.
Enfin on nous dit d'après Leon X. que si dans les monts de piété " on reçoit quelque chose au-delà du principal, ce n'est pas en vertu du prêt, c'est pour l'entretien des officiers qui y sont employés, et pour les dépenses qu'on est obligé de faire.... Ce qui n'a, dit-on, aucune apparence de mal, et ne donne aucune occasion de peché. " Ibid. p. 300. D'honnêtes usuriers diront, comme Leon X. qu'ils ne prennent rien en vertu du prêt, mais seulement pour faire subsister leur famille au moyen d'un négoce où ils mettent leurs soins et leurs fonds ; négoce d'ailleurs utîle au public, autant ou plus que celui des monts de piété, puisque nos usuriers le font à des conditions moins dures.
Mais n'allons pas plus loin sans remarquer un cercle vicieux, où tombent nos adversaires, quand ils veulent prouver le prétendu vice de l'usure légale.
Les canonistes prétendent, " avec St. Thomas, que les lois positives ne défendent si fortement l'usure, que parce qu'elle est un péché de sa nature, et par elle-même. " Conf. eccl. p. 477. Dare pecuniam mutuo ad usuram non ideò est peccatum quia est prohibitum, sed potiùs ideò est prohibitum, quia est secundum se peccatum ; est enim contra justitiam naturalem. Thom. quaest. 13. de malo. art. iv. Sur cela voici la réflexion qui se présente naturellement.
L'usure n'étant prohibée, comme ils le disent, que sur la supposition qu'elle est un péché de sa nature, quia est secundùm se peccatum ; sur la supposition qu'elle est contraire au droit naturel, quia est contra justitiam naturalem ; s'il est une fois bien prouvé que cette supposition est gratuite, qu'elle n'a pas le moindre fondement ; en un mot s'il est démontré que l'usure n'est pas injuste de sa nature, que devient une prohibition qui ne porte que sur une injustice imaginaire ? c'est ce que nous allons examiner.
Le contrat usuraire, ou le prêt lucratif, n'attaque point la divinité ; les hommes l'ont imaginé pour le bien de leurs affaires, et cette négociation n'a de rapport qu'à eux dans l'ordre de l'équité civile. Dieu ne s'y intéresse que pour y maintenir cette équité précieuse, cette égalité si nécessaire d'un mutuel avantage ; or je l'ai prouvé ci-devant, et je le repete ; on trouve cette heureuse propriété dans le prêt lucratif, en ce que d'une part le créancier ne fait à l'emprunteur que ce qu'il accepte pour lui-même ; raison à laquelle je n'ai point encore Ve de réponse, et que de l'autre, chacun y profite également de sa mise.
La mise de l'emprunteur est son industrie, cela n'est pas contesté ; mais une autre vérité non moins certaine, c'est que la mise du prêteur est une industrie encore plus grande. On ne considère pas que le sac de mille louis qu'il a livré, renferme peut-être plus de cinquante années d'une économie industrieuse, dont cette somme est le rare et le précieux fruit ; somme qui fait un ensemble, une espèce d'individu dont l'emprunteur profite à son aise et tout à la fois ; ainsi l'avantage est visiblement de son côté, puisqu'il ne constitue que quelques mois, ou si l'on veut quelques années, de son travail ; tandis que le créancier met de sa part tout le travail d'un demi siècle. Voilà donc de son côté une véritable mise qui légitime l'intérêt qu'on lui accorde : aussi les parties actives et passives, les bailleurs et les preneurs publient hautement cette légitimité ; ils avouent de bonne foi qu'ils ne sont point lésés dans le prêt lucratif, que par conséquent cette négociation n'est pas inique, vu, comme on l'a dit, qu'il n'y a pas d'injustice où il n'y a pas de lésion, et qu'il n'y a pas de lésion dans un commerce où l'on fait aux autres le traitement qu'on agrée pour soi même, dans un commerce enfin qui opère le bien des particuliers et celui du public.
Ces raisons prises dans les grands principes de l'équité naturelle, font impression sur nos adversaires ; et ils en paraissent tellement ébranlés, qu'ils n'osent pas les combattre de front ; cependant comme l'autorité entraîne, que le préjugé aveugle, et qu'enfin il ne faut pas se rendre, voici comme ils tâchent d'échapper : ils prétendent donc que la bonté du prêt lucratif ne dépend pas de l'utilité qu'en peuvent tirer les parties intéressées, parce que, disent-ils, dès qu'il est mauvais de sa nature, et opposé à l'équité naturelle.... il ne peut jamais devenir licite. Conf. eccl. p. 161. conclusion qui ne serait pas mauvaise, si elle n'était pas fondée sur une pétition de principe, sur une supposition dont nous démontrons la fausseté. Enfin la raison ultérieure qu'ils emploient contre l'équité de l'usure, raison qui complete le cercle vicieux que nous avons annoncé ; c'est qu'elle est, disent-ils, condamnée par la loi de Dieu. ibid. p. 163.
Ainsi l'usure n'est condamnée, dit-on d'abord, que parce qu'elle est injuste, quia est contra justitiam naturalem : et quand nous renversons cette injustice prétendue par des raisonnements invincibles, on nous dit alors que l'usure est injuste parce qu'elle est condamnée. En bonne foi, qui se laisse diriger par de tels raisonneurs, se laisse conduire par des aveugles.
Après avoir prouvé aux théologiens qu'ils sont en contradiction avec eux-mêmes, attachons-nous à prouver la même chose aux ministres de nos lois. On peut avancer en général que le droit civil a toujours été favorable au prêt de lucre. A l'égard de l'antiquité cela n'est pas douteux : nous voyons que chez les Grecs et chez les Romains, l'usure était permise comme tout autre négoce, et qu'elle y était exercée par tous les ordres de l'état : on sait encore que l'usure qui n'excédait pas les bornes prescrites, n'avait rien de plus repréhensible que le profit qui revenait des terres ou des esclaves ; et cela non seulement pendant les ténèbres de l'idolâtrie, mais encore dans les beaux jours du christianisme ; en sorte que les empereurs les plus sages et les plus religieux l'autorisèrent durant plusieurs siècles, sans que personne réclamât contre leurs ordonnances. Justinien se contenta de modérer les intérêts, et de douze pour cent, qui était le taux ordinaire, il les fixa pour les entrepreneurs des fabriques, et autres gens de commerce, à huit pour cent par année ; jubemus illos qui ergasteriis praesunt, vel aliquam licitam negociationem gerunt, usque ad bessem centesimae usurarum nomine in quocumque contractu suam stipulationem moderari. lib. XXVI. §. 1. vers. 1. Cod. de usuris, 4-22.
Nous sommes bien moins conséquents que les anciens sur l'article des intérêts, et notre jurisprudence a sur cela des bizarreries qui ne font guère d'honneur à un siècle de lumière. Le droit français, quant à l'expression, quant à la forme, semble fort contraire à l'usure ; quant au fond, quant à l'esprit, il lui est très-favorable. En effet, ce qui montre au mieux qu'ici la loi combat la justice ou l'utilité publique, c'est que la même autorité qui proscrit l'usure, est forcée ensuite de souffrir des opérations qui la font revivre. Chacun sait que les parties, au cas d'emprunt, conviennent de joindre dans un billet les intérêts et le principal, et d'en faire un total payable à telle échéance, ce qui se pratique également dans les actes privés et dans ceux qui se passent devant notaires. Tout le monde connait un autre détour qui n'est guère plus difficîle : on fait une obligation payable à volonté ; on obtient ensuite de concert, une sentence qui adjuge des intérêts au créancier, in poenam morae. Ecoutons sur cela l'auteur des conférences.
" Le profit qu'on tire du prêt est une usure, dit-il, parce que c'est un gain qui en provient ; et cela est défendu, parce que le prêt doit être gratuit, pour qu'il ne soit pas injuste. L'intérêt au-contraire est une indemnité légitime, c'est-à-dire un dédommagement ou une compensation due au créancier, à cause du préjudice qu'il souffre par la privation de ses deniers. Tous les théologiens conviennent que les intérêts qui sont adjugés par la sentence du juge, ne sont ni des gains ni des profits usuraires, mais des intérêts qui sont présumés très-justes et très-équittables. Legitimae usurae, dit le droit ". Conf. eccl. p. 383.
Cette distinction assez subtile, et encore plus frivole entre les profits et l'indemnité d'un prêt, est appuyée sur une décision du Droit, qui nous apprend que les intérêts ne sont pas ordonnés pour le profit des créanciers, mais uniquement pour les indemniser du retardement et de la négligence des débiteurs. Usurae non propter lucrum petentium, sed propter moram solventium infliguntur, l. XVII. §. IIIe ff. de usuris et fructibus, I. 22. Voilà, si je ne me trompe, plutôt des mots que des observations intéressantes ; que m'importe en effet, par quel motif on m'attribue des intérêts, pourvu que je les reçoive ?
Quoi qu'il en sait, tout l'avantage que trouve le débiteur dans la prohibition vague de l'usure, c'est qu'il la paye sous le beau titre d'intérêt légitime ; mais en faisant les frais nécessaires pour parvenir à la sentence qui donne à l'usure un nom plus honnête. Momerie qui fait dire à tant de gens enclins à la malignité, que notre judicature n'est en cela contraire à elle-même, que parce qu'elle se croit intéressée à multiplier les embarras et les frais dans le commerce des citoyens.
Nous l'avons déjà dit, le profit usuraire est pleinement autorisé dans plusieurs emprunts du roi, surtout dans ceux qui se font sous la forme de loteries et d'annuités ; dans plusieurs emprunts de la compagnie des Indes, et dans les escomptes qu'elle fait à présent sur le pied de cinq pour cent par année ; enfin, dans les emprunts des fermiers généraux, et dans la pratique ordinaire de la banque et du commerce. Avec de telles ressources pour l'usure légale, peut-on dire sérieusement qu'elle soit illicite ? je laisse aux bons esprits à décider.
Au reste, une loi générale qui autoriserait parmi nous l'intérêt courant, serait le vrai moyen de diriger tant de gens peu instruits, qui ne distinguent le juste et l'injuste que par les yeux du préjugé. Cette loi les guérirait de ces mauvais scrupules qui troublent les consciences, et qui empêchent d'utiles communications entre les citoyens. J'ajoute que ce serait le meilleur moyen d'arrêter les usures excessives à présent inévitables. En effet, comme il n'y aurait plus de risque à prêter au taux légal, tant sur gages que sur hypothèques, l'argent circulerait infiniment davantage. Que de bras maintenant inutiles, et qui seraient pour lors employés avec fruit ? que de gens aujourd'hui dans la détresse, et à qui plus de circulation procurerait des ressources ? En un mot, on trouverait de l'argent pour un prix modique en mille circonstances, où l'on n'en trouve qu'à des conditions onéreuses ; parce que, comme dit de Montesquieu, le prêteur s'indemnise du péril de la contravention. Esprit des lois, deuxième partie, page 121.
On nous épargnerait les frais qui se font en actes de notaires, contrôle, assignations, et autres procédures usitées pour obtenir des intérêts ; et dès-là nos communications moins gênées deviendraient plus vives et plus fructueuses, parce qu'il s'ensuivrait plus de travaux utiles. Aussi nos voisins moins capables que nous de prendre des mots pour des idées, admettent-ils l'usure sans difficulté, quand elle se borne au taux de la loi. La circulation des espèces rendue par-là plus facile, tient l'intérêt chez eux beaucoup au-dessous du nôtre ; circonstance que l'on regarde à bon droit comme l'une des vraies causes de la supériorité qu'ils ont dans le commerce. C'est aussi l'une des sources de ces prodigieuses richesses dont le récit nous étonne, et que nous croyons à peine quand nous les voyons de nos yeux.
Ajoutons un mot ici contre une espèce d'usure qui parait intolérable : je veux parler du sou pour livre que la poste exige pour faire passer de l'argent d'un lieu dans un autre. Cette facilité qui serait si utîle aux citoyens, qui ferait une circulation si rapide dans le royaume, devient presque de nul usage par le prix énorme de la remise, laquelle au reste peut s'opérer sans frais par la poste. Ses correspondances partout établies et payées pour une autre fin, ne lui sont pas onéreuses pour le service dont il s'agit. Cependant si je veux remettre cent écus, il m'en coute quinze francs ; si je veux remettre deux mille livres, on me demande dix pistoles. En bonne foi, cela est-il proposable dans une régie qui ne coute presque rien aux entrepreneurs ? Il serait donc bien à désirer que le ministère attentif à l'immense utilité qui reviendrait au commerce d'une correspondance si générale et si commode, obligeât les régisseurs ou les fermiers des postes, à faire toutes remises d'argent à des conditions favorables au public ; en un mot, qu'on fixât pour eux le droit de transport ou de banque à trois deniers par livre pour toutes les provinces de France. Il en résulterait des avantages infinis pour les sujets, et des gains prodigieux pour la ferme.
Après avoir prouvé que l'intérêt légal est conforme à l'équité naturelle, et qu'il facilite le commerce entre les citoyens, il s'agit de montrer qu'il n'est point défendu dans l'Ecriture : voyons ce que dit sur cela Moïse.
Réponse à ce qu'on allegue de l'ancien-Testament. " Si votre frère se trouve dans la détresse et dans la misere ; s'il est infirme au point de ne pouvoir travailler, et que vous l'ayez reçu comme un étranger qui n'a point d'asile, faites en sorte qu'il trouve en vous un bienfaiteur, et qu'il puisse vivre auprès de vous. Ne le tyrannisez point, sous prétexte qu'il vous doit ; craignez d'irriter le ciel en exigeant de lui plus que vous ne lui avez donné. Sait donc que vous lui prêtiez de l'argent, des grains, ou quelque autre chose que ce puisse être, vous ne lui demanderez point d'intérêt ; et quoique vous en puissiez exiger des étrangers, vous prêterez gratuitement à votre frère ce dont il aura besoin ; le tout afin que Dieu bénisse vos entreprises et vos travaux ". Exode xxij. 25. Levit. xxv. 35. Deut. xxiij. 19.
Voici comme il parle encore dans un autre endroit, Deuter. XVe 7. " Si l'un de vos frères habitant le même lieu que vous dans la terre que Dieu vous destine, vient à tomber dans l'indigence, vous n'endurcirez point votre cœur sur sa misere, mais vous lui tendrez une main secourable, et vous lui prêterez selon que vous verrez qu'il aura besoin. Eloignez de vous toutes réflexions intéressées, et que l'approche de l'année favorable qui doit remettre les dettes ne vous empêche point de secourir votre frère et de lui prêter ce qu'il vous demande, de peur qu'il ne réclame le Seigneur contre vous, et que votre dureté ne devienne criminelle. Vous ne vous dispenserez donc point de le soulager sur de mauvais prétextes ; mais vous répandrez sur lui vos bienfaits, pour attirer sur vous les bénédictions du ciel ".
Il est évident que ces passages nous présentent une suite de préceptes très-propres à maintenir le commerce d'union et de bienfaisance qui doit régner dans une grande famille, telle qu'était le peuple hébreu. Rien de plus raisonnable et de plus juste, surtout dans les circonstances où Dieu les donna. Il venait de signaler sa puissance pour tirer d'oppression les descendants de Jacob ; il leur destinait une contrée délicieuse, et il voulait qu'ils y vécussent comme de véritables frères, partageant entr'eux ce beau patrimoine sans pouvoir l'aliéner, se remettant tous les sept ans leurs dettes respectives ; enfin, s'aidant les uns les autres au point qu'il n'y eut jamais de misérables parmi eux. C'est à ce but sublime que tend toute la législation divine ; et c'est dans la même vue que Dieu leur prescrivit le prêt de bienveillance et de générosité.
Dans cette heureuse théocratie, qui n'eut Ve avec indignation des citoyens exiger l'intérêt de quelques mesures de blé, ou de quelque argent prêté au besoin à un parent, à un voisin, à un ami ? car tels étaient les liaisons intimes qui unissaient tous les Hébreux. Ils ne formaient dans le sens propre qu'une grande famille ; et ce sont les rapports sous lesquels l'Ecriture nous les présente, amico, proximo, fratre. Mais que penser des hébreux aisés, si dans ces conjonctures touchantes que nous décrit Moïse, ils se fussent attachés à dévorer la substance des malheureux, en exprimant de leur misere sous le voîle du prêt un intérêt alors détestable ?
L'intérêt que nous admettons est bien différent ; il suppose un prêt considérable fait à des gens à l'aise, moins par des vues de bienfaisance, que pour se procurer des avantages réciproques ; au lieu que les passages allégués nous annoncent des parents, des voisins, des amis, réduits à des extrémités où tout homme est obligé de secourir son semblable ; extrémités au reste qui n'exigent pas qu'on leur livre de grandes sommes. Tout ceci est étranger aux contrats ordinaires de la société, où il ne s'agit ni de ces secours modiques et passagers dont on gratifie quelques misérables, ni de ces traits de générosité qu'on doit toujours, et qu'on n'accorde que trop rarement à ses amis. Il s'agit seulement d'un négoce national entre gens aisés qui subsistent les uns et les autres, soit de leur industrie, soit de leurs fonds ; gens enfin dont il est juste que les négociations soient utiles à toutes les parties ; sans quoi tous les ressorts de la société resteraient sans action.
De plus, il faut observer ici une différence essentielle entre les Juifs et nous ; ce peuple d'agriculteurs sans faste et sans mollesse, presque sans commerce et sans procès, n'était pas comme nous dans l'usage indispensable des emprunts. A quoi les Hébreux auraient-ils employé de grandes sommes ? à l'acquisition des seigneuries et des fiefs ? cela n'était pas possible. Toutes leurs terres exemtes de vassalité, toutes en quelque sorte inaliénables, ne se pouvaient acquérir qu'à la charge de les rendre aux anciens propriétaires dans l'année de réjouissance ou de jubilé, qui revenait tous les cinquante ans. Ils ne pouvaient pas acquérir non plus des offices ou des charges, à peine les connaissait-on parmi eux ; et le peu qu'ils en avaient n'était pas dans le cas de la vénalité. Ils ne connaissaient de même ni les parties de la finance, ni la fourniture des colonies, ni tant d'autres entreprises qui sont ordinaires parmi nous. On n'armait chez eux ni pour la course, ni pour le commerce. J'ajoute qu'on pouvait être libertin et petit-maître à peu de frais ; il n'y avait là ni jeu ni spectacles ; ils se procuraient sans peine de jolies esclaves, plutôt servantes que maîtresses ; et ils en usaient librement sans éclat et sans scandale. Il ne fallait pour cela ni déranger sa fortune, ni s'abimer par les emprunts.
D'ailleurs, excepté leur capitale que la magnificence de son temple et les pélérinages prescrits par la loi, rendirent très-célèbre et très-peuplée, on ne voyait chez eux aucune ville considérable, aucune place renommée par ses manufactures ; en un mot, excepté Jérusalem, ils n'avaient guère que des bourgades. Il faut donc considérer les anciens Juifs comme de médiocres bourgeois, qui tous, ou presque tous, cultivaient un bien de campagne substitué de droit en chaque famille, qui fixés par-là dans une heureuse et constante médiocrité, se trouvaient également éloignés de l'opulence et de la misere, et qui n'avaient par conséquent ni l'occasion ni le besoin de solliciter des emprunts considérables.
Une autre observation du même genre, c'est que Ve l'égalité qui régnait entre les Israélites, ils n'avaient proprement ni rang ni dignité à soutenir ; ils n'avaient ni éducation frivole et dispendieuse à donner à leurs enfants, ni emplois civils ou militaires à leur procurer ; outre qu'avec des mœurs plus simples, ils avaient moins de serviteurs inutiles, et qu'employant leurs esclaves aux travaux pénibles, ils se chargeaient le plus souvent des soins du ménage. Sans parler de Sara qui, avec des centaines de serviteurs, cuisait elle-même des pains sous la cendre, Gen. XVIIIe 6. Sans parler de Rébecca qui, bien que fille de riche maison, et d'ailleurs pleine d'agrément, allait néanmoins à l'eau elle-même assez loin de la ville, ibid. xxiv. 16. Nous voyons dans des temps postérieurs, Absalon, fils d'un grand roi, veiller lui-même aux tondailles de ses brebis, l. II. Rois XIIIe 24. Nous voyons Thamar, sa sœur, soigner son frère Amnon qui se disait malade, et lui faire à manger, ibid. Nous voyons encore Marthe, au temps de Jesus-Christ, s'occuper des soins de la cuisine, Luc. Xe 40.
Cette simplicité de mœurs, si opposée à notre faste, rendait constamment les emprunts fort peu nécessaires aux Israélites : cependant l'usage des prêts n'était pas inconnu chez eux : un père dont les ancêtres s'étaient beaucoup multipliés, et qui n'avait dès-lors qu'un domaine à peine suffisant pour nourrir sa famille, se trouvait obligé, soit dans une mauvaise année, soit après des maladies et des pertes, de recourir à des voisins plus à l'aise, et de leur demander quelque avance d'argent ou de grains, et pour lors ces faibles emprunts, commandés par la nécessité, devenaient indispensables entre gens égaux, le plus souvent parents et amis. Au-lieu que nous qui connaissons à peine l'amitié, nous, infiniment éloignés de cette égalité précieuse qui rend les devoirs de l'humanité si chers et si pressants, nous, esclaves de la coutume et de l'opinion, sujets par conséquent à mille nécessités arbitraires, nous empruntons communément de grandes sommes, et d'ordinaire par des motifs de cupidité encore plus que pour de vrais besoins.
Il suit de ces différences, que la pratique du prêt gratuit était d'une obligation plus étroite pour les Hébreux que pour nous ; et l'on peut ajouter que Ve l'influence de la législation sur les mœurs, cette pratique leur était aussi plus naturelle et plus facile, d'autant que leurs lois et leur police entretenaient parmi eux certain esprit d'union et de fraternité qu'on n'a point Ve chez les autres peuples. Ces lois en effet, respiraient plus la douceur et l'égalité qui doivent régner dans une grande famille, que l'air de domination et de supériorité qui parait nécessaire dans un grand état.
Nous l'avons déjà vu, les acquéreurs des fonds étaient tenus à chaque jubilé, de les remettre aux anciens possesseurs. Anno jubilaei redient omnes ad possessiones suas, Lev. xxv. 13. De même tous les sept ans un débiteur, en vertu de la loi, se trouvait libéré de ses dettes ; septimo anno facies remissionem.... cui debetur aliquid ab amico vel proximo ac fratre suo repetère non poterit, quia annus remissionis est domini : Deut. XVe 2. D'un autre côté lorsqu'un Israélite avait été vendu à un compatriote, dès qu'il avait servi six années plutôt comme mercénaire que comme esclave, il sortait à la septième et devenait libre comme auparavant : on ne devait pas même le renvoyer les mains vides, et sans lui accorder quelque secours et quelque protection pour l'avenir : si paupertate compulsus vendiderit se tibi frater tuus, non eum opprimes servitude famulorum, sed quasi mercenarius et colonus erit : Lev. xxv. 39. Cum tibi venditus fuerit frater tuus hebraeus, aut hebraea, et sex annis servierit tibi, in septimo anno dimittes eum liberum, et quem libertate donaveris, nequaquam vacuum abire patieris, sed dabis viaticum, etc. Deut. XVe 12. 13. 14.
Ces pratiques et autres de même nature que la loi prescrivait aux Israélites, montrent bien l'esprit de fraternité que Dieu, par une sorte de prédilection, voulait entretenir parmi eux ; je dis une sorte de prédilection, car enfin ces dispositions si pleines d'humanité, si dignes du gouvernement théocratique, ne furent jamais d'usage parmi les Chrétiens ; le Sauveur ne vint pas sur la terre pour changer les lois civiles, ou pour nous procurer des avantages temporels ; il déclara au-contraire que son règne n'était pas de ce monde, il se défendit même de régler les affaires d'intérêt, quis me constituit judicem aut divisorem super vos. Luc xx. 14. Aussi en qualité de chrétiens nous ne sommes quittes de nos dettes qu'après y avoir satisfait. Le bénéfice du temps ne nous rend point les fonds que nous avons aliénés ; nous naissons presque tous vassaux, sans avoir pour la plupart où reposer la tête en naissant ; et les esclaves enfin qu'on voit à l'Amérique, bien que nos frères en Jesus-Christ, ne sont pas traités de nos jours sur le pied de simples mercénaires.
Ces prodigieuses différences entre les Juifs et les autres peuples, suffisent pour répondre à la difficulté que fait S. Thomas, lorsqu'il oppose que l'usure ayant été prohibée entre les Hébreux, considerés comme frères, elle doit pour la même raison l'être également parmi nous. En effet, les circonstances sont si différentes, que ce qui était chez eux facîle et raisonnable, n'est moralement parlant ni juste ni possible parmi les nations modernes. Joignez à cela que le précepte du prêt gratuit subsiste pour les Chrétiens comme pour les Israélites, dès qu'il s'agit de soulager les malheureux.
Quoi qu'il en sait, tandis que Dieu condamnait l'usure à l'égard des membres nécessiteux de son peuple, nous voyons qu'il l'autorisait avec les étrangers, par la permission expresse de la loi, foenerabis alieno, Deut. xxiij. 19. foenerabis gentibus multis, XVe 6. ib. Or peut-on dire sans blasphême que le souverain législateur eut permis une pratique qui eut été condamnée par la loi de nature : n'a-t-il pas toujours reprouvé l'adultère, la calomnie, etc. ? Concluons que dès-là l'usure ne peut être regardée comme proscrite par le droit naturel.
Allons plus loin, et disons que cette usure recommandée aux Hébreux, était un précepte d'économie nationale, une équitable compensation que Dieu leur indiquait pour prévenir les pertes qu'ils auraient essuyées en commerçant avec des peuples qui vivaient au milieu d'eux : advena qui tecum versatur in terra ; mais qui élevés dans la pratique de l'usure, et attentifs à l'exiger, auraient rendu leur commerce trop désavantageux aux Juifs, s'ils n'avaient eu droit de leur côté d'exiger les mêmes intérêts de ces peuples. En un mot les Israélites tiraient des profits usuraires de tous les étrangers, par la même raison qu'ils les poursuivaient en tout temps pour les sommes que ceux-ci leur devaient ; faculté que l'année sabbatique restraignait à l'égard de leurs concitoyens : cui debetur aliquid ab amico vel proximo ac fratre suo, repetère non poterit, quia annus remissionis est domini, a peregrino et adverso exiges. Deut. XVe 2. 3.
La liberté qu'avaient les Israélites d'exiger l'usure de l'étranger, était donc de la même nature que la liberté de le poursuivre en justice toutes les fois qu'il manquait à payer ; l'une n'était pas plus criminelle que l'autre, et bien qu'en plusieurs cas ces deux procedés leur fussent défendus entr'eux, par une disposition de fraternité qui n'a point eu lieu pour les Chrétiens, non plus que le partage des terres, et autres bons règlements qui nous manquent ; il demeure toujours constant que le prêt de lucre était permis aux Juifs à l'égard des étrangers, comme pratique équitable et nécessaire au soutien de leur commerce.
J'ajoute enfin qu'on ne saurait admettre le sentiment de nos adversaires, sans donner un sens absurde à plusieurs passages de l'Ecriture. Prenons celui-ci entr'autres : non foenerabis fratri tuo.... sed alieno. Ces paroles signifieront exactement, vous ne prêterez point à usure aux Israélites vos concitoyens et vos frères, ce serait un procédé inique et barbare que je vous défends ; néanmoins ce procedé tout inique et tout barbare qu'il est, je vous le permets vis-à-vis des étrangers, de qui vous pouvez exiger des intérêts odieux et injustes. Il est bien constant que ce n'était point là l'intention du Dieu d'Israèl. En permettant l'usure à l'égard des étrangers, il la considérait tout au plus comme une pratique moins favorable que le prêt d'amitié qu'il établit entre les Hébreux ; mais non comme une pratique injuste et barbare. C'est ainsi que Dieu ordonnant l'abolition des dettes parmi son peuple, sans étendre la même faveur aux étrangers, ne fut pour ces derniers en cela rien d'inique ou de ruineux ; il les laissa simplement dans l'ordre de la police ordinaire.
Du reste on ne saurait l'entendre d'une autre manière sans mettre Dieu en contradiction avec lui-même. Le Seigneur, dit le texte sacré, chérit les étrangers, il leur fournit la nourriture et le vêtement, il ordonne même à son peuple de les aimer et de ne leur causer aucun chagrin : amat peregrinum et dat ei victum atque vestitum, et vos ergo amate peregrinos, quia et ipsi fuistis advenae : Deut. Xe 18. advenam non contristabis : Exode xxij. 21. peregrino molestus non eris : Exode xxiij. 9. Cela posé, s'il faut regarder avec nos adversaires les usures que la loi permettait vis-à-vis des étrangers, comme des pratiques odieuses, injustes, barbares, meurtrières, il faudra convenir en même temps qu'en cela Dieu servait bien mal ses protégés : mais ne s'aperçoit-on pas enfin que toutes ces injustices, ces prétendues barbaries, ne sont que des imaginations et des fantômes de gens livrés dès l'enfance à des traditions reçues sans examen, et qui en conséquence de leurs préjugés voient seuls ensuite dans l'usure légale, des horreurs et des iniquittés que n'y voient point une infinité de gens pleins d'honneur et de lumières, qui prêtent et qui empruntent au grand bien de la société ; que ne voient pas davantage ceux qui sont à la tête du gouvernement, et qui l'admettent tous les jours dans des opérations publiques et connues ; horreurs et iniquittés enfin que Dieu ne voit pas lui-même dans le contrat usuraire, puisqu'il l'autorise à l'égard des peuples étrangers, peuples néanmoins qu'il aime, et auxquels il ne veut pas qu'on fasse la moindre peine : ama peregrinum.... peregrino molestus non eris, advenam non contristabis.
Quelques-uns ont prétendu que le foenerabis gentibus multis. Deut. xxviij. 12. n'annonçait pas un commerce usuraire, et qu'il fallait l'entendre des prêts d'amitié que les Juifs pouvaient faire à des étrangers. Mais c'est une prétention formée au hasard, sans preuve et sans fondement. Nous prouvons au-contraire qu'il est ici question des prêts lucratifs, puisque Dieu les annonce à son peuple comme des récompenses de sa fidélité, puisqu'ils se devaient faire à des nations qui étaient constamment les mêmes que celles du foenerabis alieno, nations d'ailleurs qui comme étrangères aux Israélites, leur étaient toujours odieuses.
Si vous êtes dociles à la voix du Seigneur votre Dieu, et que vous observiez ses commandements, dit Moïse, il vous élevera au-dessus de tous les peuples qui sont au milieu de vous ; il vous comblera de ses bénédictions, il vous mettra dans l'abondance au point que vous prêterez aux étrangers avec beaucoup d'avantage, sans que vous soyez réduits à rien emprunter d'eux. Si au-contraire vous êtes sourds à la voix du Seigneur, toutes les malédictions du ciel tomberont sur vos têtes ; les étrangers habitués dans le pays que Dieu vous a donné, s'éleveront au-dessus de vous, et devenus plus riches et plus puissants, bien loin de vous emprunter, ils vous prêteront eux-mêmes, et profiteront de votre abaissement et de vos pertes. Deut. xxviij. 1. 11. 12. 15. 43. 44.
De bonne foi tous ces prêts et emprunts que Moïse annonçait d'avance, pouvaient-ils être autre chose que des opérations du commerce, où l'on devait stipuler des intérêts au profit du créancier ; surtout entre des peuples qui différaient d'origine, de mœurs, et de religion ? peuples jaloux et ennemis secrets les uns des autres ; et cela dans un temps où l'usure était universellement autorisée, où elle était exigée avec une extrême rigueur, jusqu'à vendre les citoyens pour y satisfaire, comme nous le verrons dans la suite. En un mot, des peuples si discordants ne se faisaient-ils que des prêts d'amitié ? D'ailleurs supposé ces prêts absolument gratuits, les aurait-on présentés à ceux qui devaient les faire comme des avantages et des récompenses ? les aurait-on présentés à ceux qui devaient les recevoir comme des punitions et des désastres ? Peut-on s'imaginer enfin que pour rendre des hommes charnels et toujours intéressés, vraiment dociles à la voix du Seigneur, Moïse leur eut proposé comme une récompense, l'avantage risible de pouvoir prêter sans intérêt à des étrangers odieux et détestés.
Je conclus donc que le foenerabis gentibus multis, de même que le foenerabis alieno, établissent la justice de l'usure légale, quand elle se pratique entre gens accommodés, et que cette usure enfin loin d'être mauvaise de sa nature, loin de soulever des débiteurs contre leurs créanciers, paraitra toujours aux gens instruits, non-moins juste qu'avantageuse au public, et surtout aux emprunteurs, dont plusieurs languiraient sans cette ressource, dans une inaction également stérîle et dangereuse.
Réponse à ce qu'on allegue du nouveau Testament. Nous examinerons bien-tôt les passages des prophetes et des saints pères, mais voyons auparavant ceux de l'Evangîle ; et pour mieux juger, considérons les rapports qu'ils ont avec ce qui précède et ce qui suit.
" Bénissez ceux qui vous donnent des malédictions, et priez pour ceux qui vous calomnient. Si l'on vous frappe sur une joue, présentez encore l'autre, et si quelqu'un vous enlève votre manteau, laissez-lui prendre aussi votre robe. Donnez à tous ceux qui vous demandent, et ne redemandez point votre bien à celui qui vous l'enlève ; traitez les hommes comme vous souhaitez qu'ils vous traitent. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment ; si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous en font, quelle récompense en pouvez-vous attendre ? les publicains, les pécheurs en font autant. Si vous ne prêtez qu'à ceux de qui vous espérez le même service, il n'y a pas à cela grand mérite ; les pécheurs même prêtent à leurs amis dans l'espérance du retour. Pour moi je vous dis, aimez vos ennemis au point de leur faire du bien, et de leur prêter, quoique vous ne puissiez pas compter sur leur gratitude ; vous deviendrez par-là les imitateurs et les enfants du très-haut qui n'exclut de ses faveurs ni les méchants ni les ingrats. Soyez donc ainsi que votre père céleste, compatissants pour les malheureux. Luc, VIe 28. etc. Et travaillez à devenir parfaits comme lui ". Matt. Ve 48.
Qui ne voit dans tout cela un encouragement à la perfection évangélique, à la douceur, à la patience, à une bienfaisance générale semblable à celle du père céleste, estote ergo vos perfecti, mais perfection à laquelle le commun des hommes ne faurait atteindre ? Ce que nous dit ici Jesus-Christ sur le prêt désintéressé, ne diffère point des autres maximes qu'il annonce au même endroit, lorsqu'il nous recommande de ne point répéter le bien qu'on nous enleve, de laisser prendre également la robe et le manteau, de donner à tous ceux qui nous demandent, de présenter la joue à celui qui nous donne un soufflet, etc. toutes propositions qui tendent à la perfection chrétienne, et qui s'accordent parfaitement avec celle qui nous crie, aimez vos ennemis au point de les obliger et de leur prêter, quoique vous ne puissiez pas compter sur leur gratitude.
Observons au-reste sur cette dernière proposition qu'elle renferme plusieurs idées qu'il faut bien distinguer. Je dis donc qu'on doit regarder comme précepte l'amour des ennemis restreint à une bienveillance affectueuse et sincère ; mais que cette heureuse disposition pour des ennemis, n'oblige pas un chrétien à leur donner ou leur prêter de grandes sommes sans discernement, et sans égard à la justice qu'il doit à soi-même et aux siens. En un mot ce sont ici des propositions qui ne sont que de conseil, et nullement obligatoires ; autrement, si c'est un devoir d'imiter le père céleste, en répandant nos bienfaits sur tout le monde, sans exclure les méchants ni les ingrats, en prêtant à quiconque se présente, même à des libertins et à des fourbes, comme on peut l'induire d'un passage de S. Jérôme, praecipiente domino, feneramini his à quibus non speratis recipere ; in caput XVIIIe Ezéchiel S'il faut donner à tous ceux qui nous demandent, s'il ne faut pas répéter le bien qu'on nous enleve, omni potenti retribue, et qui aufert quae tua sunt ne repetas, Luc, VIe 30. Il s'ensuit qu'on ne peut rien refuser à personne, qu'on ne doit pas même poursuivre en justice le loyer de sa terre ou de sa maison ; que le titulaire d'un bénéfice n'en peut retenir que la portion congrue, et que sauf l'étroit nécessaire, chacun doit remplir gratis les fonctions de son état. Mais on sent que c'est trop exiger de la faiblesse humaine, que ce serait livrer les bons à la dureté des méchants ; et ces conséquences le plus souvent impraticables, montrent bien que ces maximes ne doivent pas être mises au rang des préceptes.
Aussi, loin de commander dans ces passages, notre divin législateur se borne-t-il à nous exhorter au détachement le plus entier, à une bienfaisance illimitée ; et c'est dans ce sens que répondant au jeune homme qui voulait s'instruire des voies du salut, voulez-vous, lui dit-il, obtenir la vie éternelle ? soyez fidèle à garder les commandements. Mais pesons bien ce qui suit ; si vous voulez être parfait, vendez le bien que vous avez, distribuez-le aux pauvres, et vous aurez un trésor dans le ciel. Si vis ad vitam ingredi, serva mandata.... Si vis perfectus esse, vade, vende quae habes et da pauperibus, etc. Matt. xjx. 17. Paroles qui démontrent qu'il n'y a point ici de précepte, mais seulement un conseil pour celui qui tend à la perfection, si vis perfectus esse ; conseil même dont la pratique ne pourrait s'étendre, sans abolir l'intérêt particulier, et sans ruiner les ressorts de la société : car enfin, s'il était possible que chacun se dépouillât de son bien, quel serait le dernier cessionnaire ; et ce qui est encore plus embarrassant, qui voudrait se charger des travaux pénibles ? De tels conseils ne sont bons que pour quelques personnes isolées qui peuvent édifier le monde par de grands exemples ; mais ils sont impraticables pour le commun des hommes, parce que souvent leur état ne leur permet pas d'aspirer à ce genre de perfection. Si, par exemple, un père sacrifiait ainsi les intérêts de sa famille, il serait blâmé par tous les gens sages, et peut-être même repris par le magistrat.
Quand Jesus-Christ fit l'énumération des préceptes au jeune homme dont nous venons de parler, il ne lui dit pas un mot de l'usure. Il n'en dit rien non plus dans une autre occasion où il était naturel de s'en expliquer, s'il l'avait jugée criminelle ; c'est lorsqu'il exposa l'excellence de sa morale, et qu'il en développa toute l'étendue en ces termes ; Matt. Ve 33. etc. Il a été dit aux anciens, vous ne ferez point de faux serment ; et moi je vous dis de ne point jurer du tout. Il a été dit, vous pourrez exiger oeil pour oeil, dent pour dent ; et moi je vous dis de présenter la joue à celui qui vous donne un soufflet. Il a été dit, vous aimerez votre prochain, mais vous pourrez haïr votre ennemi, odio habebis inimicum, ibid. 43. et moi je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'était ici le lieu d'ajouter : Il a été dit, vous pourrez prêter à usure aux étrangers, fenerabis alieno ; et moi je vous dis de leur prêter sans intérêt ; mais il n'a rien prescrit de semblable.
Au-surplus rappelons les passages qu'on nous oppose, et comparons-les ensemble pour en mieux saisir les rapports. Voici sur cela une observation intéressante.
Les actes de bienveillance et d'amitié dont parle Jesus-Christ en S. Matthieu, et qui consistent à aimer ceux qui nous aiment, à traiter nos frères avec honnêteté, si diligitis eos qui vos diligunt, si salutaveritis fratres, Ve 46. 47. De même les repas que se donnent les gens aisés, cum facis prandium aut coenam. Luc, XIVe 12. Nous pouvons ajouter d'après Jesus-Christ, les prêts usités entre les pécheurs, peccatores peccatoribus fenerantur. Luc, VIe 34. Tous ces actes opérés par le motif du plaisir ou de l'intérêt sont inutiles pour le salut ; on le sait, quam mercedem habebitis. Cependant quoique stériles, quoique éloignés de la perfection, ils ne sont pas pour cela répréhensibles. En effet serait-ce un mal d'aimer et d'obliger ceux qui nous aiment, de les recevoir à notre table, de les traiter avec les égards de la politesse et de l'amitié, de leur prêter aux conditions honnêtes auxquelles ils nous prêtent eux-mêmes ; l'Evangîle nous déclare seulement qu'il n'y a rien là de méritoire, puisque les publicains et les pécheurs en font autant.
C'est donc uniquement comme acte indifférent au salut, que Jesus-Christ nous annonce le prêt des pécheurs, lorsqu'il nous assure que ce n'est pas un grand mérite de prêter à gens avec qui nous espérons trouver quelque avantage ; si mutuum dederitis his à quibus speratis recipere, quae gratia est vobis ? nam peccatores peccatoribus foenerantur ut recipiant aequalia. Luc, VIe 34. Mais je le répete, cet acte n'est pas criminel, non plus que les bons offices rendus à des amis, à des proches, ou les repas auxquels nous les invitons. Tous ces actes ne sont point condamnés par le Sauveur ; il les déclare seulement infructueux pour la vie éternelle, quae gratia est vobis ?
Et qu'on ne dise pas comme quelques-uns, entr'autres le sorboniste Gaitte, que le prêt des pécheurs non-réprouvés de Jesus-Christ, était un prêt de bienveillance où le créancier ne retirait que sa mise. Il se fonde mal-à-propos sur ces paroles du texte, peccatores peccatoribus foenerantur ut recipiant aequalia ; foenerantur, dit le sorboniste, id est, mutuum dant, non vero foenori dant ; qui enim foenori dat, non aequalia datis, sed inaequalia recipit, quia plus recipit quam dederit. De usurâ, pag. 345. Il est visible que notre docteur a fort mal pris le sens de ces trois mots, ut recipiant aequalia. En effet, s'il fallait les entendre au sens que les pécheurs ne visaient en prêtant qu'à retirer leurs fonds ou une somme égale à celle qu'ils avaient livrée, ut recipiant aequalia ; que faisaient donc en pareil cas les gens vertueux ?
Ne voit-on pas que les pécheurs et les publicains ne pouvaient se borner ici à tirer simplement leur capital, et qu'il fallait quelque chose de plus pour leur cupidité ? Sans cela, quel avantage y avait-il pour de telles gens, et sur quoi pouvait être fondé le speratis recipere de l'Evangîle ? Plaisante raison de prêter pour des gens intéressés et accoutumés au gain, que la simple espérance de ne pas perdre le fonds ! Ou l'on prête dans la vue de profiter, ou dans la vue de rendre service, et souvent on a tout-à-la-fais ce double objet, comme l'avaient sans doute les pécheurs dont nous parlons ; mais on n'a jamais prêté uniquement pour retirer son capital ; serait-ce la peine de courir des risques ? Il faut supposer pour-le-moins aux pécheurs de l'Evangîle l'envie d'obliger des amis, et de se ménager des ressources à eux-mêmes ; aussi est-ce le vrai, l'unique sens d'ut recipiant aequalia ; expression du-reste qui n'annonce ni le lucre, ni la gratuité du prêt, n'étant ici question que du bien-fait qui lui est inhérent, quand il s'effectue à des conditions raisonnables.
Ces paroles du texte sacré, peccatores peccatoribus foenerantur ut recipiant aequalia, signifient donc que les gens les plus intéressés prêtent à leurs semblables, parce qu'ils en attendent le même service dans l'occasion. Mais cette vue de se préparer des ressources pour l'avenir n'exclut point de modiques intérêts qu'on peut envisager en prêtant, même à ce qu'on appelle des connaissances ou des amis. C'est ainsi que nos négociants et nos publicains modernes savent maintenir leurs liaisons de commerce et d'amitié, sans renoncer entr'eux à la pratique de l'intérêt légal. Il faut donc admettre du lucre dans les prêts dont parle Jesus-Christ, et qu'il dit inutiles pour le salut, mais qu'il ne réprouve en aucune manière, comme il n'a point réprouvé tant de contrats civils qui n'ont pas de motifs plus relevés que les bons offices, les repas et les prêts usités entre les pécheurs. Il faut conclure que ce sont ici de ces actes qui ne sont ni méritoires, ni punissables dans l'autre vie ; tels que sont encore les prières, les jeunes et les aumônes des hypocrites, qui ne cherchant dans le bien qu'ils opèrent que l'estime et l'approbation des hommes, ne méritent à cet égard auprès de Dieu ni punition, ni récompense, receperunt mercedem suam, Matth. VIe 1. 2. 5. 16.
Une autre raison qui prouve également que le prêt des pécheurs était lucratif pour le créancier ; c'est que s'il avait été purement gratuit, dès-là il aurait mérité des éloges. Cette gratuité une fois supposée aurait mis Jesus-Christ en contradiction avec lui-même, et il n'aurait pu dire d'un tel prêt, quae gratia est vobis ? Elle l'aurait mis aussi en contradiction avec Moïse, puisque ces prêteurs supposés si bienfaisants auraient pu lui dire : " Seigneur, nous prêtons gratuitement à nos compatriotes, et par-là nous renonçons à des profits que nous pourrions faire avec les étrangers ". Moïse, en nous prescrivant cette générosité pour nos frères, nous en promet la récompense de la part de Dieu, fratri tuo absque usura.... commodabis ut benedicat tibi Dominus. Cependant, Seigneur, vous nous déclarez qu'en cela nous n'avons point de mérite, quae gratia est vobis. Comment sauver ces contrariétés ?
Il est donc certain que les pécheurs de l'Evangîle visaient tout-à-la-fais en prêtant, à obliger leurs amis et à profiter eux-mêmes ; que par conséquent ils percevaient l'usure de tout temps admise entre les gens d'affaires, sauf à la payer également quand ils avaient recours à l'emprunt. Or le Sauveur déclarant cette négociation simplement stérîle pour le ciel, sans cependant la condamner ; le même négoce, usité aujourd'hui comme alors entre commerçans et autres gens à l'aise, doit être sensé infructueux pour le salut, mais néanmoins exempt de toute iniquitté.
Expliquons à-présent ces paroles de Jesus-Christ, Luc, VIe 35. diligite inimicos vestros, benefacite et mutuum date nihil inde sperantes. Passage qu'on nous oppose et qu'on entend mal ; passage, au reste, qui se trouve altéré dans la vulgate, et qui est fort différent dans les trois versions persane, arabe et syriaque, suivant lesquelles on doit lire : Diligite inimicos vestros, benefacite et mutuum date, nullum desperantes, nullum desperare facientes.
Le traducteur de la vulgate ayant travaillé sur le grec qui porte, , a été induit en erreur ; en voici l'occasion. Anciennement s'écrivait avec apostrophe pour l'accusatif masculin, , nullum, afin d'éviter la rencontre des deux a, qui auraient choqué l'oreille dans , nullum desperantes. Ce traducteur, qui apparemment n'avait pas l'apostrophe dans son exemplaire, ou qui peut-être n'y a pas fait attention, a pris au neutre, et l'a rendu par nihil, de sorte que pour s'ajuster et faire un sens, il a traduit non pas nihil desperantes comme il aurait dû en rigueur, mais nihil inde sperantes. En quoi il a changé l'acception constante du verbe , qui, dans tous les auteurs, tant sacrés que profanes, signifie désespérer, mettre au désespoir. Cette observation se voit plus au long dans le traité des prêts de commerce, p. 106. Mais tout cela est beaucoup mieux développé dans une savante dissertation qui m'est tombée entre les mains, et où l'auteur anonyme démontre l'altération dont il s'agit avec la dernière évidence.
Cette ancienne leçon, si conforme à ce que Jesus-Christ dit en S. Matthieu, Ve 42. " Donnez à celui qui vous demande, et n'éconduisez point celui qui veut emprunter de vous ". Qui petit à te, da ei, et volenti mutuari à te ne avertaris. Cette leçon, disje, une fois admise, lève toute la difficulté ; car dès-là il ne s'agit plus pour nous que d'imiter le Père céleste, qui répand ses dons jusque sur les méchants ; il ne s'agit plus, dis-je, que d'aimer tous les hommes, que de faire du bien, et de prêter même à nos ennemis, sans refuser nos bons offices à personne, nullum desperantes. Mais cela ne dit rien contre le prêt de commerce que l'on ferait à des riches ; cela ne prouve point qu'on doive s'incommoder pour accroitre leur opulence, parce que l'on peut aimer jusqu'à ses ennemis, et leur faire du bien sans aller jusqu'à la gratuité du prêt. En effet, c'est encore obliger beaucoup un homme aisé, surtout s'il est notre ennemi, que de lui prêter à charge d'intérêt ; et on ne livre pas ses espèces à tout le monde, même à cette condition. Pollion, dit Juvenal, cherche par-tout de l'argent à quelque denier que ce puisse être, et il ne trouve personne qui veuille être sa dupe, qui triplicem usuram praestare paratus circuit, et fatuos non invenit, sat. ix. vers. 4. On peut donc assurer que le prêt de commerce conservant toujours le caractère de bienfait, supposant toujours un fonds de confiance et d'amitié, il doit être sensé aussi légitime entre des chrétiens que les contrats ordinaires, d'échange, de louage, etc.
Mais, sans rien entreprendre sur le texte sacré, nous allons montrer que le passage tel qu'il est dans la vulgate, n'a rien qui ne se concilie avec notre opinion. Pour cela je compare le passage entier avec ce qui précède et ce qui suit, et je vois que les termes nihil inde sperantes sont indistinctement relatifs à diligite inimicos vestros, benefacite et mutuum date. Ces trois mots nous présentent un contraste parfait avec ce qui est marqué aux versets précédents, sans toucher du reste ni le lucre, ni la gratuité du prêt. Voici le contraste.
Il ne suffit pas pour la perfection que le Sauveur désire, que vous marquiez de la bienveillance ; que vous fassiez du bien ; que vous prêtiez à vos amis, à ceux qui vous ont obligé, ou de qui vous attendez des services, à quibus speratis recipere. La morale évangélique est infiniment plus pure. Si diligitis eos qui vos diligunt.... Si benefeceritis his qui vobis benefaciunt, quae vobis est gratia ? si quidem et peccatores hoc faciunt. Si mutuum dederitis his à quibus speratis recipere, quae gratia est vobis ? nam et peccatores peccatoribus foenerantur ut recipiant aequalia : verumtamen diligite inimicos vestros, benefacite et mutuum date, nihil inde sperantes, (nullum desperantes), et erit merces vestra multa, et eritis filii altissimi, quia ipse benignus est super ingratos et malos. Estote ergo misericordes, &c.
Faites, dit J. C. plus que les pécheurs, que les publicains ; ils aiment leurs amis, ils les obligent, ils leur prêtent, parce qu'ils trouvent en eux les mêmes dispositions, et qu'ils en attendent les mêmes services. Pour vous, dit-il, imitez le Père céleste, qui fait du bien aux méchants et aux ingrats ; aimez jusqu'à vos ennemis, aimez-les sincèrement au point de les obliger et de leur prêter, nihil inde sperantes, quoique vous n'en puissiez pas attendre des retours de bienveillance ou de générosité.
Maxime plus qu'humaine, bien digne de son auteur, mais qui ne peut obliger un chrétien à ne pas réclamer la justice d'un emprunteur aisé, ou à lui remettre ce qu'on lui a prêté pour le bien de ses affaires ; puisqu'enfin l'on n'est pas tenu de se dépouiller en faveur des riches. Il y a plus, Jesus-Christ ne nous commande pas à leur égard la gratuité du prêt ; il n'annonce que le devoir d'aimer tous les hommes, sans distinction d'amis ou d'ennemis ; que le devoir de les obliger de leur prêter même autant qu'il est possible, sans manquer à ce que l'on doit à soi et à sa famille ; car il faut être juste pour les siens avant que d'être généreux pour les étrangers.
D'ailleurs par quel motif ce divin maître nous porte-t-il à une bienfaisance qui s'étend jusqu'à nos ennemis ? c'est principalement par des vues de commisération, estote ergo misericordes, ibid. 36. Il ne sollicite donc notre générosité que pour le soulagement des malheureux, et non pour l'agrandissement des riches qui ne sont pas des objets de compassion, qui souvent passent leurs créanciers en opulence. Ainsi la loi du prêt gratuit n'a point été faite pour augmenter leur bien-être. Il est visible qu'en nous recommandant la commisération, estote misericordes, le Sauveur ne parle que pour les nécessiteux. Aussi, je le répete, c'est pour eux seuls qu'il s'intéresse ; vendez, dit-il ailleurs, ce que vous avez, donnez-le aux pauvres, et vous aurez un trésor dans le ciel, Matth. xix. 17. Il n'a ni commandé, ni conseillé de donner aux riches ; il n'a point promis de récompense pour le bien qu'on leur ferait, au-contraire il semble les exclure de nos bienfaits, en même-temps qu'il nous exhorte à les répandre sur les indigens. Au-lieu, dit-il, de recevoir à votre table des gens aisés, prêts à vous rendre la pareille, recevez-y plutôt des pauvres et des infirmes hors d'état de vous inviter, Luc, xiv. 12. 13.
Je demande après cela, quel intérêt Dieu peut prendre à ce que Pierre aisé prête gratis à Paul, également à son aise ? Autant qu'il en prend en ce que l'un invite l'autre à diner.
Je dis donc, suivant la morale de Jesus-Christ, qu'il faut autant que l'on peut faire du bien et prêter gratuitement à ceux qui sont dans la peine et dans le besoin, même à des ennemis de qui l'on n'attend pas de reconnaissance, et cela pour imiter le Père céleste qui répand ses dons et sa rosée sur les justes et sur les injustes. Cependant on n'est tenu de prêter gratis que dans les circonstances où l'on est obligé de faire des aumônes, dont le prêt gratuit est une espèce, au-moins vis-à-vis du pauvre. D'où il suit qu'on ne manque pas au devoir de la charité en prêtant à profit à tous ceux qui ne sont pas dans la détresse, et qui n'empruntent que par des vues d'enrichissement ou d'élévation.
J'ajoute que, d'aller beaucoup plus loin, en prêtant comme quelques-uns l'entendent, et prêtant de grandes sommes avec une entière indifférence, quasi non recepturus, dit S. Ambraise, epist. ad Vigil. c'est se livrer à la rapacité des libertins et des aventuriers ; ce n'est plus prêter, en un mot, c'est donner ; ou plutôt c'est jeter et dissiper une fortune, dont on n'est que l'économe, et que l'on doit par préférence à soi-même et aux siens.
Concluons que le prêt gratuit nous est recommandé en général comme une aumône, et dès-là comme un acte de perfection assuré d'une récompense dans le ciel ; que cependant le prêt de commerce entre gens aisés n'est pas condamné par le Sauveur ; qu'il le considère précisément comme les bons offices, de ce qu'on appelle honnêtes gens, ou les repas que se donnent les gens du monde ; actes stériles pour le salut, mais qui ne sont pas condamnables. Or il n'en faut pas davantage pour des hommes qui, en faisant le bien de la société, ne peuvent négliger leurs propres intérêts, et qui prétendent louer leur argent avec autant de raison que leurs terres ou leurs travaux. D'autant plus qu'ils suivent la règle que Jesus-Christ nous a tracée, je veux dire qu'ils ne font aux autres dans ce négoce que ce qu'ils acceptent volontiers pour eux-mêmes. Ce qui n'empêche pas que la charité ne s'exerce suivant les circonstances.
Un hôtelier charitable donne le gite gratis à un voyageur indigent, et il le fait payer à un homme aisé. Un médecin chrétien visite les pauvres par charité, tandis qu'il voit les riches par intérêt. De même l'homme pécunieux qui a de la religion, livre généreusement une somme pour aider un petit particulier dans sa détresse, le plus souvent sans sûreté pour le fonds ; et en tout cela il n'ambitionne que la récompense qui lui est assurée dans le ciel : mais est-il question de prêter de grandes sommes à des gens aisés, il songe pour-lors qu'il habite sur la terre ; qu'il y est sujet à mille besoins ; qu'il est d'ailleurs entouré de malheureux qui réclament ses aumônes ; il croit donc pouvoir tirer quelque avantage de son argent, et pour sa propre subsistance et pour celle des pauvres. Conséquemment il ne se fait pas plus de scrupule de prendre sur les riches le loyer de son argent, que de recevoir les rentes de sa terre ; et il a d'autant plus de raison d'en agir ainsi, qu'il est ordinairement plus facîle à l'emprunteur de payer un intérêt modéré, qu'il n'est facîle au créancier d'en faire l'entier abandon.
Toute cette doctrine est bien confirmée par la pratique des prêts de lucre publiquement autorisée chez les Juifs au temps de Jesus-Christ. On le voit par le reproche que le père de famille fait à son serviteur, de n'avoir pas mis son argent chez les banquiers pour en tirer du-moins l'intérêt, puisqu'il n'avait pas eu l'habileté de l'employer dans le commerce : oportuit ergo te committère pecuniam meam nummulariis, et veniens ergo recepissem utique quod meum est cum usurâ ; , cum foenore, Matth. xxv. 27.
Ce passage suffirait tout seul pour établir la légitimité de l'usure légale : Sicut enim homo peregrè proficiscens vocavit servos suos, et tradidit illis bona sua, ibid. 14. Ce père de famille qui confie son argent à ses serviteurs pour le faire valoir pendant son absence, c'est Dieu lui-même figuré dans notre parabole, qui prend cette voie pour nous instruire, simîle est regnum coelorum, ibid. Et si le passage nous offre un sens spirituel propre à nous édifier, nous y trouvons aussi un sens naturel très-favorable à notre usure. En effet, Dieu nous parle ici de l'argent qu'on porte à la banque, et des intérêts qu'on en tire comme d'une négociation très-légitime, et qu'il croit lui-même des plus utiles, puisqu'il se plaint qu'on n'en ait pas usé dans l'occasion. Du reste, ce n'est pas ici une simple similitude, c'est un ordre exprès de placer une somme à profit. Il est inutîle de dire que Jesus-Christ fait entrer quelquefois dans ses comparaisons des procédés qui ne sont pas à imiter, comme celui de l'économe infidèle et celui du juge inique, etc. Dans le premier cas, Jesus-Christ oppose l'attention des hommes pour leurs intérêts temporels à leur indifférence pour les biens célestes ; et dans le second, il nous exhorte à la persévérance dans la prière, par la raison qu'elle devient efficace à la fin, même auprès des mécans, et à plus forte raison auprès de Dieu. On sent bien que Jesus-Christ n'approuve pas pour cela les infidélités d'un économe, et encore moins l'iniquitté d'un juge.
La parabole des talents est d'une espèce toute différente ; ce ne sont pas seulement des rapports de similitude qu'on y découvre, c'est une règle de conduite pratique sur laquelle il ne reste point d'embarras. Le père de famille s'y donne lui-même pour un homme attentif à ses intérêts, pour un usurier vigilant qui ne connait point ces grands principes de nos adversaires, que l'argent est stérîle de sa nature, et ne peut rien produire, qu'on ne doit tirer d'une affaire que ce qu'on y met, etc. Il prétend au contraire que l'argent est très-fécond, et qu'il doit fructifier ou par le commerce ou par l'usure ; et non-seulement il veut tirer plus qu'il n'a mis, il veut encore moissonner où il n'a rien semé, meto ubi non semino, et congrego ubi non sparsi. Ibid.
Après cela il admet sans difficulté une pratique usuraire qu'il trouve autorisée par la police et sur laquelle il ne répand aucun nuage de blâme ou de mépris ; pratique enfin qu'il indique positivement pour tirer parti d'un fonds qu'on n'a pas eu l'industrie d'employer avec plus d'avantage. Que peut-on souhaiter de plus fort et de plus décisif pour appuyer notre usure ?
Réponse aux passages des prophetes et des saints pères. Il nous reste à voir les passages des prophetes et des pères. A l'égard des premiers, on nous oppose Ezéchiel et David, qui tous deux nous parlent de l'usure comme une œuvre d'iniquitté incompatible avec le caractère d'un homme juste. Pseaume 14 et 54. Ezéchiel ch. XVIIIe
J'observe d'abord là-dessus qu'il ne faut pas considérer les prophetes comme des législateurs. La loi était publiée avant qu'ils parussent, et ils n'avaient pas droit d'y ajouter. On ne doit donc les regarder quant à la correction des mœurs, que comme des missionnaires zélés qui s'appuyaient des lois préétablies pour attaquer des désordres plus communs de leur temps que du nôtre : ce qui est vrai surtout du brigandage des usuriers. Chez les Athéniens, l'usure ne connut de bornes que celles de la cupidité qui l'exerçait. On exigeait douze, quinze et vingt pour cent par année. Elle n'était guère moins excessive à Rome où elle souleva plus d'une fois les pauvres contre les riches. Elle y était fixée communément par mois au centième du capital : ce qui fait douze pour cent par année ; encore allait-elle souvent au-delà; de sorte que cette centésime ruineuse qui portait chaque mois intérêt d'intérêt, nova usurarum auctio per menses singulos, dit S. Ambraise de Tobia, c. VIIIe cette centésime dévorante engloutissait bientôt toute la fortune de l'emprunteur. Ce n'est pas tout, les créanciers faute de payement, après avoir discuté les biens d'un insolvable, devenaient maîtres de sa personne, et avaient droit de le vendre pour en partager le prix, parteis secanto, dit la loi des douze tables. S'il n'y avait qu'un créancier, il vendait de même le débiteur, ou il l'employait pour son compte à divers travaux, et le maltraitait à son gré. Tite-Live rapporte là-dessus un trait qu'on ne sera pas fâché de retrouver ici. Liv. II. n °. 23, l'an de Rome 260.
" La ville se trouvait, dit-il, partagée en deux factions. La dureté des grands à l'égard des peuples et surtout les rigueurs de l'esclavage auxquelles on soumettait les débiteurs insolvables, avaient allumé le feu de la discorde entre les nobles et les plébéïens. Ceux-ci frémissaient de rage, et marquaient publiquement leur indignation, en considérant qu'ils passaient leur vie à combattre au-dehors pour assurer l'indépendance de la république et pour étendre ses conquêtes, et que de retour dans leur patrie, ils se voyaient opprimés et mis aux fers par leurs concitoyens, tyrants plus redoutables pour eux que leurs ennemis mêmes. L'animosité du peuple se nourrit quelque temps de ces plaintes ; un événement singulier la fit éclater enfin par un soulevement général.
On vit un jour un vieillard couvert de haillons qui paraissait fuir vers la place ; un visage pâle, un corps exténué, une longue barbe, des cheveux hérissés lui donnaient un air hagard et sauvage, et annonçaient en lui le comble de la misere. Quoiqu'il fût ainsi défiguré, on le reconnut bientôt ; on apprit qu'il avait eu autrefois du commandement dans l'armée, et qu'il avait servi avec honneur ; il en donnait des preuves en montrant les blessures dont il était couvert. Le peuple que la singularité du spectacle avait rassemblé autour de lui, parut d'avance fort sensible à ses malheurs ; chacun s'empresse de lui en demander la cause. Il dit que pendant qu'il portait les armes contre les Sabins, sa maison avait été pillée et brulée par les ennemis, qui avaient en même temps pris ses bestiaux et ruiné sa récolte : qu'après cela les besoins de la république ayant exigé de fortes contributions, il avait été obligé d'emprunter pour y satisfaire, et que les usures ayant beaucoup augmenté sa dette, il avait vendu d'abord son patrimoine, et ensuite ses autres effets ; mais que cela ne suffisant pas encore pour l'acquitter, il s'était Ve réduit par la rigueur de la loi à devenir l'esclave de son créancier, qui en conséquence non-seulement l'avait accablé de travaux, mais l'avait encore excédé par des traitements honteux et cruels, dont il montrait les marques récentes sur son corps meurtri de coups. A cette vue il s'élève un cri qui porte le trouble dans toute la ville. Les plébéïens mutinés se répandent dans tous les quartiers, et mettent en liberté tous les citoyens détenus pour dettes. Ceux-ci se joignant aux premiers, et implorant la protection du nom romain, augmentent la sédition ; à chaque pas il se présente de nouveaux compagnons de révolte, etc. "
Nous trouvons dans l'histoire sainte des traits également intéressants sur le même sujet. Nous y apprenons que l'usure était si ruineuse parmi les Juifs, et qu'on en exigeait le payement avec tant de rigueur, que les emprunteurs étaient quelquefois réduits pour y satisfaire, à livrer leurs maisons, leurs terres et jusqu'à leurs enfants. Néhémie, au temps d'Esdras, vers l'an 300 de Rome, envoyé par Artaxerxès Longuemain pour commander en Judée, et pour rebâtir Jérusalem, nous en parle comme témoin oculaire, et nous en fait un récit des plus touchans. Esdras, l. II. ch. Ve
" Les pauvres, dit-il, accablés par leurs frères, c'est-à-dire leurs concitoyens, parurent disposés à un soulevement ; on vit sortir en foule hommes et femmes remplissant Jérusalem de plaintes et de clameurs. Nous avons plus d'enfants que nous n'en pouvons nourrir, disaient les uns ; il ne nous reste plus d'autre ressource que de les vendre pour avoir de quoi vivre. Nous sommes forcés, disaient les autres, d'emprunter à usure et d'engager notre patrimoine, tant pour fournir à nos besoins que pour payer les tributs au roi ; sommes-nous de pire condition nous et nos enfants que les riches qui nous oppriment, et qui sont nos frères ? Cependant nos enfants sont dans l'esclavage, et nous sommes hors d'état de les racheter, puisque nous voyons déjà nos champs et nos vignes en des mains étrangères ".
Néhémie attendri, parla vivement aux magistrats et aux riches, de l'usure qu'ils exigeaient de leurs frères. " Vous savez, leur dit-il, que j'ai racheté, autant qu'il m'a été possible, ceux de nos frères qui avaient été vendus aux étrangers ; vous au contraire, vous les remettez dans l'esclavage, pour que je les en retire une seconde fais. Votre conduite est inexcusable ; elle prouve que la crainte du Seigneur ne vous touche pas ; et vous vous exposez au mépris de nos ennemis ". Ils ne surent que répondre à ce juste reproche. Il leur dit donc alors : " Nous avons prêté à plusieurs, mes frères, mes gens et moi, nous leur avons fourni sans intérêt de l'argent et du grain ; faisons tous ensemble un acte de générosité ; remettons à nos frères ce qu'ils nous doivent, et en conséquence qu'on leur rende sur le champ leurs maisons et leurs terres, et qu'il ne soit plus question de cette centesime que vous avez coutume d'exiger tant pour l'argent que pour les grains, l'huîle et le vin que vous leur prêtez. Sur cela chacun promit de tout rendre : ce qui fut aussi-tôt exécuté ". Ibid.
Mais dans quel siècle voyait-on chez les Juifs une usure si générale ? usure que les prêtres mêmes exerçaient, puisque Néhémie leur en parla, et leur fit promettre d'y renoncer à l'avenir. Vocavi sacerdotes et adjuravi eos us facèrent, etc. Ibid. Ve 12. Tout cela se pratiquait au siècle même d'Ezéchiel, au retour de la captivité, c'est-à-dire dans un temps où ces peuples paraissaient rentrer en eux-mêmes, et travailler de concert à réparer les désastres qu'une longue absence et de longues guerres avaient attirés sur leur patrie.
L'usure n'était pas moins onéreuse aux pauvres sous le règne de David, puisqu' annonçant en prophète la prospérité future de Salomon, son successeur et son fils, il prédit que cet heureux monarque délivrerait le pauvre de l'oppression des riches, et qu'il le garantirait des violences de l'usure. Psaumes 71. 12. 13. 14.
Voilà donc l'usure établie parmi le peuple de Dieu ; mais remarquons que le roi prophète parle d'une usure qui attaque jusqu'à la vie des nécessiteux, animas pauperum salvas faciet, ex usuris et iniquittate redimet animas eorum. Ibid.
Ezéchiel suppose aussi l'usure exercée par un brigand, qui désole principalement les pauvres et les indéfendus. Latronem... egenum et pauperem contristantem, ad usuram dantem. XVIIIe 12. 13. Rappelons ici que l'usure légale était la centésime pour l'argent, c'est-à-dire douze pour cent par année ; mais c'était bien pis pour les grains : c'était cinquante pour cent d'une récolte à l'autre. Si summa crediti in duobus modiis fuerit, tertium modium ampliùs consequantur... quae lex ad solas pertinet fruges, nam pro pecuniâ ultra singulas centesimas creditor vetatur accipere. Cod. theod. tit. de usuris. C'était véritablement exercer l'usure contre les pauvres ; car on ne voit que de telles gens emprunter quelques mesures de grain ; mais c'était exercer une usure exorbitante, et qui parait telle aujourd'hui aux hommes les plus intéressés.
Après cela faut-il s'étonner que des prophetes aient confondu le commerce usuraire avec l'injustice, avec la fraude et le brigandage ? Combien ne devaient-ils pas être touchés en voyant ces horreurs dans une nation, dont les membres issus d'une souche commune et connue étaient proprement tous frères et tous égaux ; dans une nation à laquelle Dieu avait donné les lois les plus douces et les plus favorables, et où il ne voulait pas enfin qu'il y eut personne dans la misere. Omninò indigens et mendicus non erit inter vos. Deut. XVe 4.
Dans ces circonstances, l'usure ne fournissait aux prophetes que trop de sujets de plaintes et de larmes. Ces saints personnages voyaient avec douleur que de pauvres familles ne trouvaient dans l'emprunt qu'un secours funeste qui aggravait leur misere, et qui souvent les conduisait à se voir dépouillés de leurs héritages, à livrer jusqu'à leurs enfants pour apaiser leurs créanciers. Nous l'avons Ve dans le récit de Néhémie. Ecce nos subjugamus filios nostros et filias nostras in servitutem, etc. Esdr. IIe 55. On le voit encore dans les plaintes de cette veuve pour qui Elisée fit un miracle, dans le temps qu'on allait lui enlever ses deux fils. Ecce creditor venit ut tollat duos filios meos ad serviendum sibi. IV. Reg. iv. 1.
Nous avons déjà dit que la médiocrité qui faisait l'état des Hébreux, dispensait les riches de recourir aux emprunts, et qu'ainsi l'on ne prêtait guère qu'à des pauvres qui pouvaient seuls se trouver dans le besoin. Du reste s'il se faisait quelques prêts entre les gens aisés, comme l'usure modérée était permise par le droit naturel, Moïse, de l'aveu du P. Semelier, le toléra dans les Juifs ad duritiam cordis.... à l'égard des riches et des étrangers. Conf. eccl. p. 130. Mais le sanhedrin ou le conseil de la nation était au-moins dans les dispositions de cette prétendue tolérance, puisque les magistrats eux-mêmes exerçaient l'usure au temps de Néhémie. Increpavi, dit-il, optimates et magistratus, loco cit. Ve 7, puisqu'au temps de Jesus-Christ, la police permettait le commerce usuraire qui se faisait avec les banquiers, comme on l'a Ve par le passage de S. Matthieu ; et comme on le voit dans S. Luc, quare non dedisti pecuniam meam ad mensam, ut ego veniens cum usuris utique exegissem illam. xix. 23.
Au surplus, on ne trouve nulle part que les prophetes se soient élevés contre la pratique respective d'un intérêt modique, ni à l'égard des étrangers, ni même entre leurs concitoyens aisés. Ces hommes divins parlant d'après Moïse, n'ont condamné comme lui que cette usure barbare qui dévorait la misérable substance du nécessiteux, et qui le réduisait lui et sa famille aux extrémités cruelles de la servitude ou de la mendicité. Tels étaient les abus qui faisaient gémir les prophetes, et c'est en conséquence de ces désordres, qu'ils mettaient l'usure au rang des crimes, et qu'ils la regardaient comme l'infraction la plus odieuse de cette charité fraternelle dont Dieu avait fait une loi en faveur des pauvres, populo meo pauperi, Exode xxij. 23.
Une observation qui confirme ce qu'on vient de dire, c'est que Néhémie ne se plaint de l'usure qu'il trouva établie en Judée, que parce qu'elle s'exerçait sur des pauvres citoyens, et qu'elle les avait réduits à de grandes extrémités. On voit même que bien qu'il eut le pouvoir en main, il ne s'était pas mis en devoir d'arrêter ce désordre, jusqu'à ce que les plaintes et les clameurs d'un peuple désespéré lui eurent fait appréhender un soulevement. Du reste, on peut dire en général que l'obligation de prêter aux indigens était bien mal remplie chez les Hébreux ; en effet, si les plus accommodés avaient été fidèles à cet article de la loi, on n'aurait pas Ve si souvent les pauvres se livrer comme esclaves à quelque riche compatriote : ce n'était à la vérité que pour six années, après quoi la faveur de la loi les rétablissait comme auparavant, et les déchargeait de toute dette antérieure ; ce qui était toujours moins dur que l'esclavage perpétuel ailleurs usité en pareilles circonstances.
Qu'on me permette sur cela une réflexion nouvelle et qui me parait intéressante. Qu'est-ce proprement qu'acheter un esclave ? c'est à parler en chrétien avancer une somme pour délivrer un infortuné que l'injustice et la violence ont mis aux fers. A parler selon l'usage des anciens et des modernes, c'est se l'assujettir de façon, qu'au lieu de lui rendre la liberté suivant les vues d'une bienfaisance religieuse, au-lieu de lui marquer un terme pour acquitter par son travail ce qu'on a déboursé pour lui, on opprime un frère sans défense, et on le réduit pour la vie à l'état le plus désolant et le plus misérable. Peut-on pécher plus griévement contre la charité fraternelle et contre la loi du prêt gratuit ? loi constamment obligatoire vis-à-vis des pauvres et des opprimés. Cette observation, pour peu qu'on la presse, démontre qu'il n'est pas permis d'asservir pour toujours tant de malheureux qu'on trafique aujourd'hui comme une espèce de bétail, mais à qui suivant la morale évangélique, l'on doit prêter sans intérêt de quoi se libérer de la servitude, et par conséquent à qui l'on doit fixer un nombre d'années pour recouvrer leur liberté naturelle, après avoir indemnisé des maîtres bienfaisants qui les ont rachetés. Voilà un sujet bien plus digne d'alarmer les âmes timorées, que les prêts et les emprunts qui s'opèrent entre gens aisés, dans la vue d'une utilité réciproque.
Quoi qu'il en sait, l'usure était défendue aux Israélites à l'égard de leurs compatriotes malheureux ; mais on ne voit pas qu'elle le fût à l'égard des citoyens aisés, et c'est surquoi les prophetes n'ont rien dit : du reste, si l'on veut qualifier cette prohibition de loi générale qui devait embrasser également les indigens et les riches, il faut la regarder alors comme tant d'autres pratiques de fraternité que Dieu, par une prédilection singulière, avait établie chez les Hébreux ; mais cette loi supposée n'obligera pas plus les chrétiens, que le partage des terres, que la remise des dettes et les autres institutions semblables qui ne sont pas venues jusqu'à nous, et qui paraitraient incompatibles avec l'état actuel de la société civile.
Il résulte de ces observations, que les passages d'Ezéchiel et de David ne prouvent rien contre nos prêts de commerce : prêts qui ne se font qu'à des gens aisés qui veulent augmenter leur fortune. Il ne s'agit pas ici, comme dans les faits que nous offre l'histoire sacrée, de la commisération dû. aux nécessiteux ; ces gens-ci sont fort étrangers dans la question de l'intérêt moderne, et je ne sçais pourquoi on les y produit si souvent. Ils s'offraient autrefois tout naturellement dans la question de l'usure, par la raison entr'autres, que les créanciers avaient sur les débiteurs ces droits exorbitants déjà rapportés ; mais aujourd'hui que cette loi barbare n'existe plus, et qu'un insolvable se libère par une simple cession, on n'a proprement aucune prise sur les pauvres. Aussi ne leur livre-t-on pour l'ordinaire que des bagatelles qu'on veut bien risquer ; ou si on leur prête une somme notable, on ne les tourmente pas pour les intérêts, on est très-content quand on retire son capital.
Quant aux pères de l'église que l'on nous oppose encore, ils avaient les mêmes raisons que les prophetes ; ils plaidaient comme eux la cause des infortunés. Ils représentent avec force à ceux qui exerçaient l'usure, qu'ils profitent de la misere des pauvres pour s'enrichir eux-mêmes ; qu'au lieu de les soulager comme ils le doivent, ils les écrasent et les asservissent de plus en plus. Usuras solvit qui victu indiget.... panem implorat, gladium porrigitis ; libertatem obsecrat, servitutem irrogatis. Ambr. de Tobia, c. IIIe
S. Grégoire de Nazianze dit que l'usurier ne tire son aisance d'aucun labour qu'il donne à la terre, mais de la détresse, du besoin des pauvres travailleurs ; non ex terrae cultu, sed ex pauperum inopiâ et penuriâ commoda sua comparants. Orat. 15.
S. Augustin considère aussi le prêt lucratif par le tort qu'il fait aux nécessiteux, et il l'assimîle à un vol effectif. Le voleur, dit-il, qui enlève quelque chose à un homme riche, est-il plus cruel que le créancier qui fait périr le pauvre par l'usure ? An crudelior est qui substrahit aliquid vel eripit diviti, quam qui trucidat pauperem foenore. Epit. 54. ad Maced.
C'est encore la misere du pauvre qui parait affecter S. Jérôme sur le fait de l'usure. Il y a, dit-il, des gens qui prêtent des grains, de l'huîle et d'autres denrées aux pauvres villageais, à condition de retirer à la récolte tout ce qu'ils ont avancé, avec la moitié en sus, amplius mediam partem. Ceux qui se piquent d'équité, continue-t-il, n'exigent que le quart au-dessus de leur avance, qui justissimum se putaverit, quartam plus accipiet. In cap. XVIIe Ezéchiel Cette dernière condition, qui était celle des scrupuleux, faisait pourtant vingt-cinq pour cent pour huit ou dix mois au plus : usure vraiment excessive, et réellement exercée contre le faible et l'indéfendu.
On le voit, ces dignes pasteurs ne s'intéressent que pour la veuve et l'orphelin ; pour les pauvres laboureurs et autres indigens, sur le sort desquels ils gémissent, et qui par les excès de l'usure ancienne, par la rigueur des poursuites jadis en usage, ne méritaient que trop toute leur commisération. Mais tant de beaux traits qui marquent si bien la sensibilité des pères sur le malheur des pauvres, n'ont aucun rapport avec les prêts de commerce usités entre les riches. En effet, l'agrandissement de ceux-ci ne touchait pas assez nos saints docteurs pour qu'ils songeassent à leur assurer la gratuité de l'emprunt. C'est dans cet esprit que S. Jérôme écrivant à Pammaque qui voulait embrasser la pauvreté évangélique, l'exhorte à donner son bien aux indigens, et non à des riches, déjà trop enflés de leur opulence ; à procurer le nécessaire aux malheureux, plutôt qu'à augmenter le bien-être de ceux qui vivaient dans le faste. Da pauperibus, non locupletibus, non superbis ; da quo necessitas sustentetur, non quo augeantur opes. Epist. 54. ad Pammaq.
Le soulagement des pauvres était donc le grand objet des saints pères, et non l'avantage temporel des riches ; avantage qui dans les vues de la piété, leur était fort indifférent. Il l'était en effet au point, qu'ils ne discutent pas même les prêts qu'on peut faire aux gens aisés ; ou s'ils en disent un mot par occasion, ce qui est rare, ils donnent tout lieu de croire qu'ils sont légitimes, quand ils se font sans fraude et aux conditions légales ; en voici des exemples.
Saint Grégoire de Nysse ayant prêché vivement contre la pratique de l'usure, toujours alors excessive et souvent accompagnée de barbarie, les gens pécunieux dirent publiquement qu'ils ne prêteraient plus aux pauvres. Minantur se pauperibus non daturos mutuum ; ce qui marque assez qu'ils ne renonçaient pas aux prêts qu'ils faisaient aux personnes aisées ; aussi ne les leur interdisait-on pas. Cependant si S. Grégoire avait été dans le sentiment de nos casuistes, il n'aurait pas manqué d'exposer à ses auditeurs que la prohibition de l'usure était égale pour tous les cas d'aisance ou de pauvreté ; qu'en un mot, les prêts de lucre étaient injustes de leur nature, tant à l'égard du riche qu'à l'égard du nécessiteux ; mais il ne dit rien de semblable ; et sans chicaner ses ouailles sur les prêts à faire aux gens aisés, il ne s'intéresse que pour les malheureux. Il déclare donc qu'il faut faire des aumônes pures et simples ; et quant aux prêts qui en sont, dit-il, une espèce, il assure de même qu'on est tenu d'en faire ; ensorte, ajoute-t-il, qu'on se rend également coupable, soit qu'on prête à intérêt, soit qu'on refuse de prêter ; et cette dernière alternative ne pouvait être vraie qu'en la rapportant aux seuls pauvres, autrement sa proposition était évidemment insoutenable. Aequè obnoxius est poenae qui non dat mutuum, et qui dat sub conditione usurae. Contra usurarios.
Mais écoutons S. Jean Chrysostome, nous verrons que les intérêts qu'on tire des gens aisés, n'étaient pas illicites, et qu'il ne les condamnait pas lui-même. " Si vous avez, dit-il, placé une somme à charge d'intérêts entre les mains d'un homme solvable, sans doute que vous aimeriez mieux laisser à votre fils une bonne rente ainsi bien assurée, que de lui laisser l'argent dans un coffre, avec l'embarras de le placer par lui-même ". Si argentum haberes sub foenore collocatum et debitor probus esset ; malles certè syngrapham quam aurum filio relinquere ut inde proventus ipsi esset magnus, nec cogeretur alios quaerere ubi posset collocare. Joan. Chrysost. in Matt. homil. lxvj. et lxvij. p. 660. lit. b. tom. VII. édit. D. Bern. de Montfaucon.
Il s'agit, comme l'on voit, d'un prêt de lucre et de l'intérêt que produit un capital inaliéné, puisqu'on suppose que le père eut pu le retirer pour le laisser à ses enfants, et que d'ailleurs les contrats de constitution n'étaient pas alors en usage entre particuliers. Conf. de Paris, tom. II. l. II. p. 318. Du reste, notre saint évêque parle de cette manière de placer son argent, comme d'une pratique journalière et licite ; il ne répand lui-même aucun nuage sur cet emploi, et il n'improuve aucunement l'attention du père à placer ses fonds à intérêts et d'une façon sure, afin d'épargner cette sollicitude aux siens. Ces deux passages ne sont pas les seuls que je pusse rapporter, mais je les crois suffisans pour montrer aux ennemis de l'usure légale qu'ils n'entendent pas la doctrine des pères à cet égard.
Au reste, si les docteurs de l'église ont approuvé les prêts de commerce entre personnes aisées, il est d'autres prêts absolument iniques contre lesquels ils se sont justement élevés avec les lois civiles ; ce sont ces prêts si funestes à la jeunesse dont ils prolongent les égarements, en la conduisant à la mendicité et aux horreurs qui en sont la suite. S. Ambraise nous décrit les artifices infâmes de ces ennemis de la société, qui ne s'occupent qu'à tendre leurs filets sous les pas des jeunes gens, dans la vue de les surprendre et de les dépouiller. Adolescentulos divites explorant per sous.... aiunt nobîle praedium esse venale... praetendunt alienos fundos adolescenti ut eum suis spolient, tendunt retia, &c.
Voilà des mystères d'iniquitté que les avocats de l'intérêt légal sont bien éloignés d'autoriser ; mais à ces procédés odieux, joignons les barbaries que S. Ambraise dit avoir vues, et que l'on croit à peine sur son témoignage. L'usure de son temps était toujours excessive, toujours la centésime qui s'exigeait tous les mois, et qui non-payée accraissait le capital usurae applicantur ad sortem, ibid. c. VIIe nova usurarum auctio per menses singulos, cap. VIIIe Si à la fin du mois l'intérêt n'était pas payé, il grossissait le principal au point qu'il faisait au bout de l'an plus que le denier huit, et qui en voudra faire le calcul, trouvera qu'un capital se doublait en moins de six ans. Pour peu donc qu'un emprunteur fût malheureux, pour peu qu'il fût négligent ou dissipateur, il était bientôt écrasé. Les suites ordinaires d'une vie licencieuse étaient encore plus terribles qu'à présent : malheur à qui se livrait à la mollesse et aux mauvais conseils. On obsédait les jeunes gens qui pouvaient faire de la dépense, et comme dit S. Ambraise, les marchands de toute espèce, les artisans du luxe et des plaisirs, les parasites et les flatteurs conspiraient à les jeter dans le précipice ; je veux dire, dans les emprunts et dans la prodigalité. Bientôt ils essuyaient les plus violentes poursuites de la part de leurs créanciers, exactorum circum latrantum barbaram instantiam, dit Sidoine lib. IV. epist. 24. On faisait vendre leurs meubles, et on leur arrachait jusqu'à la vie civile, en les précipitant dans l'esclavage. Alios proscriptioni addicit, alios servituti, Ambr. de Tob. c. XIe Aussi voyait-on plusieurs de ces malheureux se pendre ou se noyer de désespoir. Quanti se propter foenus strangulaverunt ! Ibid. cap. VIIIe Quam multi ob usuras laqueo sese interemerunt vel praecipites in fluvios dejecerunt ! Greg. Niss. contra usurarios.
Quelquefois les usuriers mettaient le fils en vente pour acquitter la dette du père. Vidi ego miserabîle spectaculum liberos pro paterno debito in auctionem deduci. Ambr. ibid. c. VIIIe Les pères vendaient eux-mêmes leurs enfants pour se racheter de l'esclavage. S. Ambraise l'atteste encore comme un fait ordinaire ; il est difficîle de lire cet endroit sans verser des larmes ; vendit plerumque et pater liberos autoritate generationis, sed non voce pietatis. Ad auctionem pudibundo vultu miseros trahit dicens.... vestro pretio redimitis patrem, vestrâ servitute paternam emitis libertatem. Ibid. cap. VIIIe
Après cela peut-on trouver étrange que nos saints docteurs aient invectivé contre le commerce usuraire, et qu'ils y aient attaché une idée d'injustice et d'infamie, que des circonstances toutes différentes n'ont encore pu effacer ? Ne voit-on pas qu'ils n'ont été portés à condamner l'usure qu'à cause des cruautés qui l'accompagnaient de leur temps ? Aussi l'attaquent-ils sans cesse, comme contraire à la charité chrétienne, et à la commisération que l'on doit à ses semblables dans l'infortune. Ils parlent toujours du prêt gratuit comme d'un devoir que la nature et la religion nous imposent ; et par conséquent, je le répete, ils n'ont eu en vue que les pauvres ; car encore un coup, il est constant que personne n'est tenu de prêter gratis aux gens aisés. Ces saints docteurs n'exigent donc pas qu'un homme prête à son désavantage pour augmenter l'aisance de son prochain. En un mot, ils n'ont jamais trouvé à redire que l'homme pécunieux cherchât des emprunteurs solvables pour tirer de ses espèces un profit honnête, ou comme dit saint Chrysostome, ut inde proventus ipsi esset magnus. Mais du reste nous ne soutenons que l'intérêt de la loi, intérêt qu'elle n'autorise que parce qu'il est équitable, nécessaire, et dès-là sans danger pour la société. Voyons à présent s'il a toujours été approuvé par la législation, et si elle a prétendu le proscrire, quand elle a sévi contre les usuriers.
Nous dirons donc sur cet objet, que c'est uniquement pour arrêter le brigandage de l'usure, que les législateurs ont si souvent prohibé le commerce usuraire ; mais dans ce cas, il faut toujours entendre un négoce inique, préjudiciable au public et aux particuliers, tel que l'ont fait autrefois en France les Italiens et les Juifs.
Saint Louis qui régna dans ces temps malheureux voyant que l'usure était portée à l'excès, et ruinait ses sujets, la proscrivit tout à fait par son ordonnance de 1254. Mais ce n'était ni un mot que l'on condamnait alors, ni ce modique intérêt qu'exige le bien public, et que les puissances de la terre n'empêcheront pas plus que le cours des rivières. C'était une usure intolérable, c'était en un mot l'usure des Juifs et des Lombards, qui s'engraissaient dans ce temps-là des miseres de la France. La loi leur accordait l'intérêt annuel de 4 sols pour livre, quatuor denarios in mense, quatuor solidos in anno pro librâ. Cela faisait vingt pour cent par année, que l'on réduisait à quinze pour les foires de Champagne. C'est ce que l'on voit par une ordonnance de 1311 publiée sous Philippe le Bel, qui monta sur le trône quinze ans après la mort de saint Louis. Ce taux excessif ne satisfaisait pas encore l'avidité des usuriers. Le cardinal Hugue, contemporain de notre saint roi, nous les représente comme des enchanteurs, qui, sans battre monnaie, faisaient d'un tournois un parisis, sine percussione mallei faciunt de turonensi parisiense, Hug. card. in psal. 14. c'est-à-dire, que pour vingt sols ils en tiraient vingt-cinq ; ce qui fait le quart en sus, ou 25 pour cent ; usure vraiment exorbitante, et qui méritait bien la censure des casuistes et la sévérité des lois.
Ce fut dans ces circonstances que saint Louis, témoin des excès de l'usure, et des vexations qui s'ensuivaient contre les peuples, la défendit tout à fait dans le royaume. Mais par-là ce prince manqua le but qu'il se proposait ; et dans un siècle d'impolitie et de ténèbres qui souffrait les guerres particulières, qui sanctifiait les croisades, dans un siècle de superstition, qui admettait le duel et l'épreuve du feu pour la conviction des criminels, dans un siècle, en un mot où les vrais intérêts de la religion et de la patrie étaient presque inconnus, saint Louis en proscrivant toute usure, donna dans un autre excès qui n'opéra pas encore le bien de la nation. Il arriva bientôt, comme sous l'empereur Basile, que l'invincible nécessité d'une usure compensatoire fit tomber en désuétude une loi qui contrariait les vues d'une sage police, et qui anéantissait les communications indispensables de la société. C'est ce qui parut évidamment en ce que l'on fut obligé plusieurs fois de rappeler les usuriers étrangers, à qui l'on accordait quinze et vingt pour cent d'un intérêt que la loi rendait licite ; et qui par mille artifices en tiraient encore davantage.
Il résulte de tous ces faits, que si les puissances ont frappé l'usure, leurs coups n'ont porté en général que sur celle qui attaquant la subsistance du pauvre, et le patrimoine d'une jeunesse imprudente, mine par-là peu-à-peu et ronge insensiblement un état. Mais cette usure détestable ne ressemble que par le nom à celle qui suit les prêts de commerce ; prêts qui ne portent aujourd'hui qu'un intérêt des plus modiques, prêts en conséquence recherchés par les meilleurs économes, et qui par l'utîle emploi qu'on en peut faire, sont presque toujours avantageux à l'homme actif et intelligent.
Ces réflexions au reste sont autant de vérités solennellement annoncées par une déclaration que Louis XIV. donna en 1643, pour établir des monts de piété dans le royaume. Ce prince dit, que les rois ses prédécesseurs.... ont, par plusieurs édits et ordonnances, imposé des peines à ceux qui faisaient le trafic illicite de prêter argent à excessif intérêt... nous voulons, dit ce monarque, employer tous les efforts de notre autorité royale pour renverser tout-à-la-fais et les fondements, et les ministres de cette pernicieuse pratique d 'usure qui s'exerce dans les principales villes de notre royaume. Et d'autant que le trafic de l'emprunt et du prêt d'argent est très-utîle et nécessaire dans nos états... nous avons voulu établir des monts de piété, abolissant de cette sorte et le pernicieux trafic des usuriers, et le criminel usage des usures qu'on y rend arbitraires, à la ruine des familles. Conf. eccl. p. 298.
On voit que ce prince veut empêcher simplement les excès d'une usure arbitraire et ruineuse pour les sujets, et non pas, pesez bien les termes, le trafic de l'emprunt et du prêt d'argent, qu'il déclare très-utile, nécessaire même, quoique l'intérêt dont il s'agissait alors fût bien au-dessus du denier vingt. On devait payer par mois trois deniers pour livre au mont de piété ; ce qui fait trente-six deniers ou trois sols par an, triplicam usuram. Conf. eccl. p. 300.
Au surplus, Louis XIV. ne fait ici que suivre des principes invariables de leur nature, et absolument nécessaires en toute société policée. Philippe le Bel, dans l'ordonnance de 1311, ci-dessus alléguée, avait déjà senti cette vérité. Il avait reconnu plusieurs siècles avant Louis XIV. qu'il est un intérêt juste et raisonnable, que l'on ne doit pas confondre avec une usure arbitraire et préjudiciable à tout un peuple, graviores usuras, ce sont les termes, substantias populi gravius devorantes prosequimur attentius atque punimus. Mais il ne manque pas d'ajouter expressément qu'il ne prétend pas empêcher qu'un créancier n'exige, outre le principal qui lui est dû. un intérêt légitime du prêt, ou de quelqu'autre contrat licite, dont il peut tirer de justes intérêts. Verum per hoc non tollimus quominus impunè creditor quilibet interesse legitimum praeter sortem sibi debitum possit exigère ex mutuo, vel alio contractu quocumque licito ex quo interesse rationabiliter et licite peti possit vel recipi. Guenais, confér. des ordon. t. I. l. IV. tit. j. p. 621 et 623, édit. de Paris, 1678.
Il y avait donc des prêts alors, qui sans autre formalité, produisaient par la convention même un intérêt légitime, comme aujourd'hui dans le Bugey, interesse legitimum ex mutuo, ou comme on trouve encore au même endroit, lucrum quod de mutuo recipitur, et par conséquent cet intérêt, ce profit s'exigeait licitement ; sans doute parce qu'il était juste et raisonnable ; rationabiliter et licite peti possit. Il n'est rien de tel en effet que la justice et la raison, c'est-à-dire, dans notre sujet, l'intérêt mutuel des contractants ; et nos adversaires sont obligés de s'y rendre eux-mêmes. Voici donc ce que dit le père Sémelier sur l'ordonnance de 1311. Il est vrai que Philippe le Bel ne prétend pas empêcher qu'un créancier ne puisse exiger au-delà du principal qui lui est dû un intérêt légitime du prêt.... mais l'on n'est pas en droit d'inférer que ce prince ait par-là autorisé le prêt de commerce, [il a pourtant autorisé le lucrum quod de mutuo recipitur].... il en faut seulement conclure qu'il permet que le créancier, par le titre du lucre cessant, ou du dommage naissant, reçoive des intérêts légitimes ; nous le dirons dans le livre sixième qui suit, mais alors, ajoute notre conférencier, ce n'est plus une usure. Confér. ecclésiast. p. 136.
Puisque cet intérêt si juste que l'on tire du prêt, cet interesse legitimum ex mutuo, ce lucrum quod de mutuo recipitur, n'est pas un profit illicite, ou ce que l'école appelle une usure, nous sommes enfin d'accord, et nous voilà heureusement réconciliés avec nos adversaires ; car c'est-là tout ce que nous prétendons. était-ce la peine de tant batailler pour en venir à un dénouement si facîle ?
J'avais bien raison de dire en commençant que tout ceci n'était qu'une question de mots. On nous accorde en plein tout ce que nous demandons ; de sorte qu'il n'y a plus de dispute entre nous, si ce n'est peut-être sur l'odieuse dénomination d'usure, que l'on peut abandonner, si l'on veut, à l'exécration publique, en lui substituant le terme plus doux d'intérêt légal.
Qu'on vienne à présent nous objecter les prophetes et les pères, les constitutions des papes et les ordonnances des rais. On les lit sans principe, on n'en voit que des lambeaux, et on les cite tous les jours sans les entendre et sans en pénétrer ni l'objet, ni les motifs ; ils n'envisagent tous que l'accomplissement de la loi, ou, ce qui est ici la même chose, que le vrai bien de l'humanité ; or, que dit la loi sur ce sujet, et que demande le bien de l'humanité ? Que nous secourions les nécessiteux et par l'aumône, et par le prêt gratuit, ce qui est d'autant plus facile, qu'il ne leur faut que des secours modiques. Voilà dans notre espèce à quoi se réduisent nos devoirs indispensables, et la loi ne dit rien qui nous oblige au-delà. Dieu connait trop le néant de ce qu'on nomme commodités, fortune et grandeur temporelle pour nous faire un devoir de les procurer à personne, soit en faisant des dons à ceux qui sont dans l'aisance, ou, ce qui n'est pas moins difficile, en prêtant des grandes sommes sans profit pour nous. En effet, qu'un homme s'incommode et nuise à sa famille pour prêter gratis à un homme aisé, où est-là l'intérêt de la religion et celui de l'humanité ?
Revenons donc enfin à la diversité des temps, à la diversité des usages et des lois. Autrefois l'usure était exorbitante, on l'exigeait des plus pauvres, et avec une dureté capable de troubler la paix des états ; ce qui la rendait justement odieuse. Les choses ont bien changé ; les intérêts sont devenus modiques et nullement ruineux. D'ailleurs, grâce à notre heureuse législation, comme on n'a guère de prise aujourd'hui sur la personne ; les barbaries qui accompagnaient jadis l'usure, sont inconnues de nos jours. Aussi ne prête-t-on plus qu'à des gens réputés solvables ; &, comme nous l'avons déjà remarqué, les pauvres sont presque toujours de trop dans la question présente. Si l'on est donc de bonne foi, on reconnaitra que les prêts de lucre ne regardent que les gens aisés, ou ceux qui ont des ressources et des talents. On avouera que ces prêts ne leur sont point onéreux, et que bien différents de ceux qui avaient cours dans l'antiquité, jamais ils n'ont excité les clameurs du peuple contre les créanciers. On reconnaitra même que ces prêts sont très-utiles au corps politique, en ce que les riches fuyant presque toujours le travail et la peine, et par malheur les hommes entreprenants étant rarement pécunieux, les talents de ces derniers sont le plus souvent perdus pour la société, si le prêt de lucre ne les met en œuvre. Conséquemment on sentira que si la législation prenait là-dessus un parti conséquent, et qu'elle approuvât nettement le prêt de lucre au taux légal, elle ferait, comme on l'a dit, le vrai bien, le bien général de la société, elle nous épargnerait des formalités obliques et ruineuses ; et nous délivrerait tout-d'un-coup de ces vaines perplexités qui ralentissent nécessairement le commerce national.
C'est affoiblir des raisons triomphantes que de les confirmer par des autorités dont elles n'ont pas besoin. Je cede néanmoins à la tentation de rappeler ici l'anonyme, qui, sur la fin du dernier siècle, nous donna la pratique des billets ; un autre qui a publié dans ces derniers temps un in-4°. sur les prêts de commerce ; ouvrage qui l'emporte beaucoup sur le premier, et qui fut imprimé à Lille en 1738. Je cite encore avec Bayle le célèbre de Launoy, docteur de Paris, le père Séguenot, de l'oratoire, M. Pascal, M. le premier président de Lamoignon, etc. Je cite de même M. Perchambaut, président du parlement de Bretagne ; et pour dire encore plus, Dumoulin, Grotius, Puffendorf, Saumaise et Montesquieu. Tous ces grands hommes ont regardé comme légitimes de modiques intérêts pris sur les gens aisés, et ils n'ont rien aperçu dans ce commerce qui fût contraire à la justice ou à la charité. Voyez Nouvelles de la république des lettres, Mai 1685, p. 571, F. de V.
Victricem meditor justo de faenore causam
Annus hic undecies dum mihi quintus adest.
Article de M. FAIGUET. (1758.)
USURE, s. f. (Jurisprudence) il ne faut pas confondre l'usure avec le profit que l'on tire du louage, ce profit étant toujours permis, lorsqu'on le perçait pour une chose susceptible de location, et qu'il est réglé équitablement.
On n'entend par usure que le profit que l'on tire du prêt ; encore faut-il distinguer deux sortes de prêts, appelés par les Latins commodatum et mutuum.
Le premier que nous appelons commodat, ou prêt à usage, faute d'expression propre dans notre langue pour le distinguer de l'autre sorte de prêt appelé mutuum, est celui par lequel on donne gratuitement une chose à quelqu'un, pour en user pendant un certain temps, sous condition de la rendre en nature après le temps convenu. Ce prêt doit être gratuit, autrement ce serait un louage.
L'autre prêt appelé mutuum, quasi mutuatio, est celui par lequel une chose fungible, c'est-à-dire qui peut être remplacée par une autre, comme de l'or ou de l'argent, monnoyé ou non, du grain, des liqueurs, etc. est donnée à quelqu'un pour en jouir pendant un certain temps, à condition de rendre, non pas la même chose identiquement, mais la même quantité et qualité.
Ce prêt appelé mutuum, devait aussi être gratuit ; et lorsqu'il ne l'était pas, ce qui était contre la nature de ce contrat, on l'appelait foenus, quasi foetus, seu partus ; et le profit que l'on tirait de l'argent, ou autre chose fungible ainsi prêtée, fut ce que l'on appela usura, usure.
On voit dans l'Exode, ch. xxij. que le prêt gratuit appelé mutuum, était usité ; mais il n'y est pas parlé du prêt à usure.
Le ch. xxiij. du Deutéronome le défend expressément : Non foenerabis fratri tuo ad usuram pecuniam, nec fruges, nec quamlibet aliam rem, SED ALIENO. Fratri tuo absque usura, id quod indiget commodabis, ut benedicat tibi Dominus, &c.
Il était donc défendu de prêter à usure à son frère, c'est-à-dire à toute personne de même nation ou alliée. Il n'y avait d'exception que pour les étrangers, qui étaient tous regardés comme ennemis. Aussi S. Ambraise regarde-t-il comme deux actions égales, de sévir contre les ennemis par le fer, ou tirer de quelqu'un l'usure du prêt ; et il pense qu'on ne peut l'exiger que contre ceux qu'il est permis de tuer.
Mais la loi de l'Evangile, beaucoup plus parfaite que celle de Moïse, défend de prêter à usure, même à ses ennemis : diligite inimicos vestros, benefacite, et mutuum date, nihil inde sperantes, et erit merces vestra multa. Luc, VIe
Les conciles et les papes se sont aussi élevés fortement contre les prêts à usure. Ils prononcent la suspension des bénéfices contre les clercs, et l'excommunication contre les laïcs qui ont le malheur d'y tomber. On peut voir là-dessus le tit. de usuris, aux decrétales ; le canon episcopis, dist. 47. et plusieurs autres.
Cependant l'usure punitoire ou conventionnelle, est permise en certains cas par le droit canon.
Chez les Romains, comme parmi nous, toute usure n'était pas défendue ; mais seulement l'usure lucratoire, lorsqu'elle était excessive. Elle ne devait pas excéder un certain taux dont on était convenu, autrement le prêteur était déclaré infâme, et puni de la peine du quadruple ; en quoi l'usurier était traité plus rigoureusement que les voleurs ordinaires, dont la peine n'était que du double.
Aussi les choses étaient-elles portées à un tel excès, que l'on ne rougissait point de tirer un pour cent par mois d'intérêt, qui est ce que l'on appelait usure centésime. Cet abus s'était perpétué jusqu'au temps de Justinien, malgré les défenses réitérées de ses prédécesseurs, que cet empereur renouvella en prescrivant la manière dont il était permis de percevoir les intérêts.
En France, les ordonnances de nos rois ont toujours réprouvé le commerce d'usure, en quoi l'on s'est conformé à la doctrine de l'Eglise et au droit canon.
On a seulement distingué l'intérêt licite, de celui qui ne l'est pas, auquel on applique plus volontiers le terme d'usure.
Non-seulement on admet parmi nous les usures compensatoires, légales, et celles qu'on appelle punitoires ou conventionnelles, mais même l'usure lucratoire, pourvu qu'elle n'excède pas le taux permis par l'ordonnance : toutes ces usures sont reputées légitimes.
Mais l'usure lucratoire n'a lieu parmi nous qu'en quatre cas ; savoir, 1°. dans le contrat de constitution de rente ; 2°. pour les intérêts qui viennent ex morâ et officio judicis ; 3°. dans les actes à titre onéreux, autres que le prêt, tels que transactions pour intérêts civils ou pour rentes, de droits incorporels, ou de choses mobiliaires en gros ; 4°. pour deniers pupillaires, ce qui n'a lieu que contre le tuteur, tant que les deniers sont entre ses mains.
Il y a cependant quelques pays où il est permis de stipuler l'intérêt de l'argent prêté, comme en Bretagne et en Bresse, et à Lyon entre marchands, ou pour billets payables en payement. Voyez aux décrétales, au digeste et au code, les tit. de usuris ; et les traités de usuris, de Salmasius, et autres auteurs indiqués par Brillon au mot usure, Gregorius Tholosanus, Dumoulin, Donat, tractatus contractuum et usurarum, Bouchel, et les mots CONTRAT DE CONSTITUTION, INTERET, PRET, OBLIGATION, USURIER. (A)
USURE BESSALE, chez les Romains était l'intérêt à huit pour cent par an. Elle était ainsi appelée du mot bes, qui signifiait huit parties de l'as, ou somme entière.
USURE CENTESIME n'était pas, comme quelques interpretes l'ont pensé, un intérêt de cent pour cent par an ; car jamais une usure si énorme ne fut permise. L'usure centésime la plus forte qui ait eu lieu chez les Romains, était celle qui dans le cours de cent mois égalait le sort principal, au moyen de ce que de cent deniers on en payait un par mois ; car les anciens avaient coutume de compter avec leurs débiteurs tous les mois, et de se faire payer l'intérêt chaque mois. Un denier par mois faisait douze deniers par an, ou le denier douze. Ainsi pour appliquer cela à nos valeurs numéraires, cent livres tournois, chacune de vingt sols, et le sol de douze deniers, l'usure centésime aurait été d'une livre tournois par mois, et douze livres tournois par an ; ce qui en huit ans et quatre mois égalerait le sort principal.
Cette usure considérable s'était perpétuée chez les Romains jusqu'au temps de Justinien, malgré les défenses réitérées de ses prédécesseurs qu'il renouvella. Voyez Budaeus de asse, Hermolaus Barbarus, Aegidius Dosanus, Alciatus, Molinaeus de usuris, Gregorius Tholosanus, et les mots INTERET, USURE UNCIALE. (A)
USURE CIVILE, Pline donne ce nom aux usures semisses, parce que c'étaient les plus fortes des usures communes. Voyez Gregorius Tholosanus, liv. II. ch. IIIe
USURE COMPENSATOIRE, est celle par laquelle on se dédommage du tort que l'on a reçu, ou du profit dont on a été privé, propter damnum emergens, vel lucrum cessants.
Cette usure n'a rien de vicieux, ni de repréhensible suivant les lois et les canons, parce que hors le cas d'une nécessité absolue, l'on n'est pas obligé de faire le profit d'un autre à son préjudice.
C'est sur ce principe qu'il est permis au vendeur de retirer les intérêts du prix d'un fonds dont il n'est pas payé, et ce en compensation des fruits que l'acquéreur perçait.
Il en est de même des intérêts de la dot, exigible et non payée, de ceux de la légitime ou portion héréditaire, d'une soute de partage, ou d'un reliquat de compte de tutele.
Cette usure compensatoire est aussi appelée légale, parce qu'elle est dû. de plein droit et sans convention.
USURE CONVENTIONNELLE, est l'intérêt qui est dû en vertu de la stipulation seulement, à la différence des intérêts qui sont dû. de plein droit en certains cas, et que l'on appelle par cette raison usures légales.
L'usure punitoire est du nombre des usures conventionnelles. Voyez USURE LEGALE et USURE PUNITOIRE.
USURE DEUNCE, était l'intérêt à onze pour cent par an ; le terme deunce signifiant onze parties de l'as ou somme entière.
USURE DEXTANTE, était l'intérêt à dix pour cent par an, dextants signifiant dix parties de l'as ou principal. Voyez USURE UNCIALE.
USURE DODRANTE, était l'intérêt à neuf pour cent par an, car dodrants signifiait neuf parties de l'as. Voyez USURE UNCIALE, USURE SEXTANTE, etc.
USURE LEGALE, c'est l'intérêt qui est dû de plein droit, en vertu de la loi et sans qu'il soit besoin de convention, comme cela a lieu en certains cas, par exemple pour les intérêts du prix de la vente d'un fonds, pour les intérêts d'une dot non payée, d'une part héréditaire, légitime, soute de partage, etc. Voyez USURE COMPENSATOIRE.
USURE LEGITIME, on appelait ainsi chez les Romains, le taux d'intérêt qui était autorisé et le plus usité, comme l'usure trientale, c'est-à-dire à 4 pour 100, ou l'usure quinquunce, c'est-à-dire à 5 pour 100 par an ; on donna cependant aussi quelquefois ce nom à l'usure centesime ou à 12 pour 100 par an ; qui était la plus forte de toutes, parce qu'elle était alors autorisée par la loi, ou du-moins qu'elle l'avait été anciennement, et qu'elle s'était perpétuée par un usage qui avait acquis force de loi. Voyez l'histoire de la jurisp. rom. de M. Terrasson.
USURE LUCRATIVE ou LUCRATOIRE, est celle qui est perçue sans autre cause, que pour tirer un profit de l'argent ou autre chose prêtée ; cette sorte d'usure est absolument approuvée par le Droit canonique et civil, si ce n'est lorsqu'il y a lucrum cessants ou damnum emergens, comme dans le cas du contrat de constitution. Voyez CONTRAT DE CONSTITUTION et INTERET.
USURE MARITIME, nauticum foenus, est l'intérêt que l'on stipule dans un contrat à la grosse ou à la grosse aventure ; cet intérêt peut excéder le taux de l'ordonnance, à cause du risque notable que court le prêteur de perdre son fonds. Voyez au digeste le titre de nautico foenore. L'ordonnance de la marine, l. III. tit. 5. le commentaire de M. Valin sur cette ordonnance, et le mot GROSSE AVANTURE.
USURE MENTALE, est celle qui se commet sans avoir été expressément stipulée par le prêteur, lorsqu'il donne son argent, dans l'espérance d'en retirer quelque chose au-delà du sort principal. Cette usure est défendue aussi-bien que l'usure réelle, mutuum date nihil inde sperantes. Luc VIe
USURE NAUTIQUE, voyez USURE MARITIME.
USURE PUNITOIRE ou CONVENTIONNELLE, est le profit qui est stipulé en certains cas par forme de peine, contre celui qui est en demeure de satisfaire à ce qu'il doit.
Cette sorte d'usure, quoique moins favorable que la compensation, est cependant autorisée en certains cas, même par le Droit canon ; par exemple, en fait d'emphytéose, où le preneur est privé de son droit, lorsqu'il laisse passer deux ans sans payer le canon emphytéotique ; 2°. en matière de compromis, où celui qui refuse de l'exécuter dans le temps convenu, est tenu de payer la somme fixée par le compromis ; 3°. en matière de testament, dont l'héritier est tenu de remplir les conditions ou de subir la peine qui lui est imposée par le testament. Voyez le traité des crimes, par M. de Vouglans, tit. 5. ch. VIIe
USURE QUADRANTE, était l'intérêt à 3 pour 100 par an, car le terme de quadrants signifiait la troisième partie de l'as ou somme entière.
USURE QUINQUUNCE, était l'intérêt à 5 pour 100 par an, quinquunce étant la cinquième partie de l'as ou somme entière.
USURE REELLE, est celle que l'on commet réellement et de fait, en exigeant des intérêts illicites d'une chose prêtée ; on l'appelle aussi réelle pour la distinguer de l'usure mentale, qui est lorsque le prêt a été fait dans l'intention d'en tirer un profit illicite, quoique cela n'ait pas été stipulé ni exécuté. Voyez USURE MENTALE.
USURE SEMISSE, était l'intérêt à 6 pour 100 par an ; semi était la moitié de l'as ou six parties du total qui se divisait en 12 onces.
USURE SEPTUNCE, était l'intérêt à 7 pour 100 par an, ainsi appelé, parce que septunx signifiait sept parties de l'as.
USURE SEXTANTE, c'était lorsque l'on tirait l'intérêt à 2 pour 100 par an, car sextants était la sixième partie de l'as ou 2 onces.
USURE SEMI UNCIALE, était celle qui ne produisait que la moitié d'une once par an, ou un demi denier par mois. Voyez USURE CENTESIME et USURE UNCIALE.
USURE TRIENTALE ou TRIENTE, était chez les Romains l'intérêt à 4 pour 100 par an ; en effet, triens était la quatrième partie de l'as, il en est parlé au code de usuris.
USURE UNCIALE, on appelait ainsi chez les Romains l'intérêt que l'on tirait au denier 12 d'un principal, parce que l'as qui se prenait pour la somme entière était divisé en 12 onces ou parties ; de sorte que l'usure unciale était une once d'intérêt, non pas par mois, comme quelques-uns l'ont cru, mais seulement par an, ce qui ne faisait qu'un denier par mois ; autrement on aurait tiré 100 pour 100 par an, ce qui ne fut jamais toleré ; ainsi l'usure unciale ou centésime était la même chose, voyez ci-devant USURE CENTESIME. Voyez aussi Cornelius Tacitus, annal. lib. XV. Gregorius Tholosanus. (A)